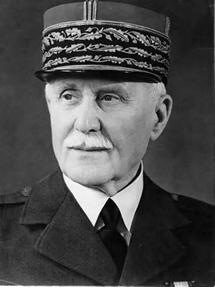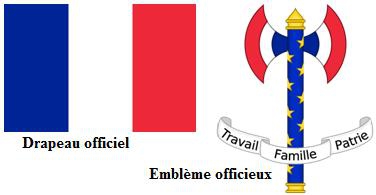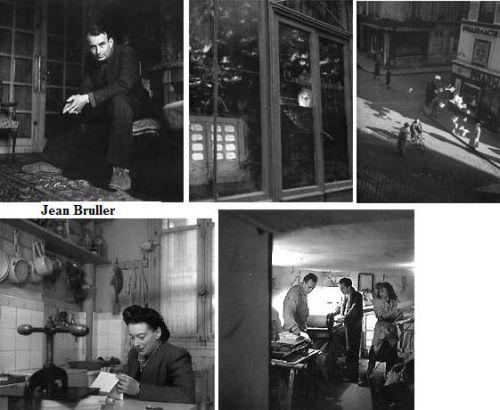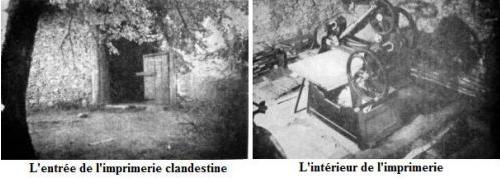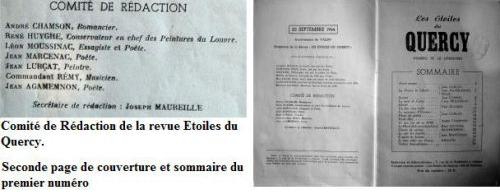HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE
HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE
On estime que les faits de résistances en France ont concerné 1% à 1,5% de la population, et pourtant cette résistance est très divisée.
On devrait en effet plutôt dire les résistances françaises. On distingue en fait deux ensembles : une résistance extérieure et une résistance intérieure (de plus, cette dernière est divisée en plusieurs groupes).
La résistance extérieure
Les débuts de la résistance française sont à placer en dehors du sol français. Elle commence en effet le 18 juin 1940 par l'appel lancé par le général de Gaulle, de Londres, sur la radio anglaise, la BBC.
Cet appel marque la naissance de la France Libre. En juillet 1940, la France Libre ce sont seulement 7.000 hommes environ autour de de Gaulle à Londres.
Peu de colonies se rallient à la bannière de de Gaulle (l'AEF Afrique Equatoriale Française, Tahiti, et la Nouvelle-Calédonie). Le reste de l'Empire français reste fidèle à Vichy.
Pour rajouter à la faiblesse de de Gaulle, la France Libre n'est pas reconnue par les Alliés comme un gouvernement en exil et, la France libre n'a pas de lien, pas de contact avec les premiers mouvements de résistance en France.
La résistance intérieure
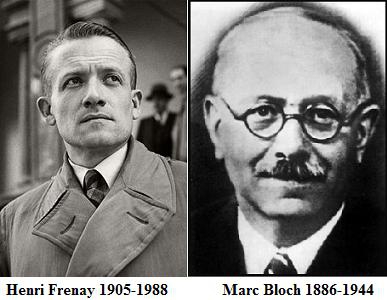
La résistance intérieure commence à se manifester par des actes isolés dès juillet 1940 (distributions de tracts, inscriptions sur les murs).
En zone sud, l'absence des Allemands facilite la formation spontanée, parfois désordonnée de groupes (ou réseaux) comme Combat Henri Frenay, ou encore Franc-Tireur Marc Bloch.

Le siège de la Gestapo, Prinz-Albrecht-Straße à Berlin
C'est Hermann Goering, alors ministre de l'Intérieur de Prusse qui crée la Gestapo le 26 avril 1933. C'est alors la transformation de la police politique organisée par la République de Weimar en 1919 pour lutter contre les communistes. Goering décide de placer cette police politique sous l'autorité du chef des services de police du ministère de l'Intérieur, Rudolph Diels et de lui donner des pouvoirs spéciaux. Cette nouvelle police se répand dans les divers Lànder (régions d'Allemagne) et se détache de l'administration normale pour passer sous l'autorité personnelle de Goering.
En zone nord, la situation est plus difficile pour les résistants qui doivent rapidement s'organiser en réseaux clandestins s'ils veulent échapper à la Gestapo.
Les premiers groupes sont Libération nord, Ceux de la Résistance.
Seul le Front National, groupe de résistants communistes, fondé en mai 1941 mais surtout actif à partir de juillet 1941, est présent en zone nord et en zone sud.
Le problème de tous ces mouvements de résistance jusqu'à la fin de l'année 1941, c'est qu'ils sont divisés, parfois concurrents, faiblement implantés dans les régions et globalement mal organisés.
Organisation et unification de la résistance française
C'est pour l'essentiel l'œuvre de Jean Moulin, ancien préfet, rallié à la France libre, et envoyé par de Gaulle en France en janvier 1942. Jean Moulin assure dès juillet 1942 le lien entre la France Libre et la résistance intérieure.
Jean Moulin unit les résistants du sud de la France en créant les Mouvements Unis de la Résistance (MUR) en janvier 1943. Et le 27 mai 1943, il réunit sous l'autorité de de Gaulle l'ensemble des mouvements de résistants français au sein du CNR (Conseil National de la Résistance).
La mission de Jean Moulin s'arrête un mois plus tard : le 21 juin 1943 : il est arrêté, torturé par la Gestapo lyonnaise, et décède lors de son transfert en Allemagne juillet 1943.
Du CNR au GPRF
Le Conseil National de la Résistance, uni sous l'autorité de de Gaulle, donne au général une nouvelle légitimité.
Depuis mai 1943, de Gaulle est en Algérie, qui a été reconquise par les Alliés et les Forces Françaises Libres ou FFL (armée de la France Libre). Le 3 juin 1943, il devient le chef du Comité Français de Libération Nationale, mais il partage ce poste avec le général Giraud, qui est soutenu par les Américains.
De Gaulle réussit finalement à se débarrasser de Giraud pour s'imposer comme le seul chef de la France libre. Il sera à partir de juin 1944, le chef du Gouvernement Provisoire de la République Française (GPRF).
Nés en 1941, les Francs-Tireurs et Partisans (placés d'abord sous l'autorité communiste) ont du mal à se soumettre à l'autorité des FFI, les relations sont difficiles et suspicieuses entre les deux groupes. Malgré tout l'action rapproche les deux mouvances : la guérilla, les sabotages, les déraillements des trains et l’élimination des traitres sont le lot commun de ces Résistants. Les FTP deviennent très influants après le débarquement des Alliés en juin 1944 au sein des FFI, ce qui explique la dissolution des FTP le 22 octobre 1944 par le gouvernement provisoire de la République Française (GPRF).
La résistance française, tant intérieure (les FFI, Forces Françaises de l'Intérieur qui accomplissent la libération de Paris) qu'extérieure (les FFL, Forces Françaises Libres qui libèrent le sud de la France), participent à la libération de la France aux côtés des Alliés.
Alors que le maréchal Pétain et le gouvernement de Vichy sont amenés par les Allemands à Sigmaringen, le GPRF est reconnu par les Français comme le pouvoir légal. De Gaulle remonte triomphalement les Champs-Élysées fin août 1944. Il envoie les premiers préfets pour relayer l'autorité des chefs résistants et dissoudre les organisations paramilitaires. Le nom de régime de Vichy désigne le régime politique dirigé par le maréchal Philippe Pétain, qui assure le gouvernement de la France au cours de la Seconde Guerre mondiale, du 10 juillet 1940 au 20 août 1944 durant l’occupation du pays par les forces armées du Troisième Reich, et dont le siège se situe à Vichy, situé en zone libre jusqu'en novembre 1942.
Après le Vote des pleins pouvoirs à Philippe Pétain le 10 juillet 1940 par l’Assemblée nationale, la mention République française » disparaît des actes officiels. Le régime est dès lors désigné sous le nom d’État français. Du fait de son aspect particulier dans l’histoire de France, de sa légitimité contestée et du caractère générique de son nom officiel, le régime est le plus souvent désigné sous les appellations régime de Vichy, gouvernement de Vichy, voire simplement Vichy. Au début de l'année 1945, le GPRF est reconnu à l'étranger comme le gouvernement légal de la France. La parenthèse de la guerre et celle du régime de Vichy se referment donc avec l'année 1944.
L’IMPRIMERIE DE LA RÉSISTANCE
Tous les textes traitant des imprimeries clandestines ont donné la priorité aux auteurs des textes, l'imprimeur, lui, n'apparaît que très modestement. Obéissant à l'écrivain, le typographe avec son plomb à patte, n'avait pas grande chance de pouvoir s'envoler en cas de danger.
Je me souviens de Roger Lescaret dont l'atelier était situé derrière l'Institut. Arrêté après perquisitions, incarcéré quatre mois à la Santé, ensuite pendant dix mois au camp de Rouillé. Dès sa libération, il recommence à imprimer pour l'organisation militaire clandestine.
Et Comte dans le quartier du Champs de Mars qui avait installé une Phoenix dans sa cave. Un meuble était poussé sur la trappe, lui travaillait pour Témoignage chrétien.
Et encore Harambat, avec sa barbiche de vieil artisan. C'était l'image de l'innocence. Un innocent qui imprimait tranquillement pour le MLN.
Vercors, pseudonyme du graveur Jean Bruller. Contacté par Pierre de Lescure dès le début de l'Occupation, il écrivit Le Silence de la mer pour la revue La Pensée libre fondée par Jacques Decour et Georges Politzer.
Claude Oudeville, imprimeur, composa Le Silence de la mer à la main. Tirage : trois cent cinquante exemplaires.
Yvonne Desvignes, à son domicile près du Trocadéro, plia et cousu les trois cent cinquante exemplaires du Silence de la mer, tandis que Vercors en personne les colla.

Monsieur Philippe a été pour moi la lampe de poche de l'ouvreuse me guidant dans le cinéma d'épouvante de l'Occupation. Le premier jour il m'avait fait un peu peur. Bien sûr, j'avais bricolé quelques papiers pour des amis dans la difficulté, mais il me déboulait dessus, bien renseigné, et me demanda de jouer avec lui de façon moins artisanale. A la Libération, comme d'autres quittant leurs noms de station de métro, il est devenu Enrico Pontremoli. On le voit ici avec Olga, sa femme, et Philippeau confectionnant quelques papillons lithographiques destinés à être collés sur l'Affiche rouge.

Imprimerie Défense de la France
LA PRESSE CLANDESTINE
Les imprimeurs et distributeurs de la presse clandestine ont payé un très lourd tribut à leur mission d’information d’une population soumise en permanence à la propagande vichyste et pro-allemande. Il est essentiel, à l’époque, que la presse clandestine atteste, par sa présence, des milliers d’initiatives des réseaux et des mouvements qui couvrent le pays, et qu’elle soutienne le moral et les espoirs des Français.
Ses difficultés sont pourtant considérables. Il faut trouver, détourner le papier, matière contingentée, rare et surveillée. Il faut disposer de ronéos, d’imprimeries typographiques utilisant des plombs composés sur le marbre des journaux légaux. Des mouvements parviennent même à trouver des heures de quelques linotypes lourdes. La distribution, aussi hasardeuse que la fabrication, se fait par les canaux les plus divers : trains, avec la complicité des cheminots, vélos puis dépôts dans les boîtes aux lettres, sous les portes, ou jets à la volée de multiples exemplaires. Hormis un creux de la fin 1941 à la fin 1942, dû surtout à l’efficacité de la répression, le nombre des publications ne cesse de croître, pour dépasser la centaine mi-1943.

Appartement parisien transformé par Michel Bernstein en atelier de faux-papiers
Parmi les titres les plus distribués, citons : en zone sud, Combat, Libération et Franc Tireur, créés dès 1941, qui atteignent respectivement 300 000 (pour le premier) et 150 000 (pour les deux autres) exemplaires. En zone nord, Défense de la France, qui tire courant janvier 1944 jusqu’à 400 000 exemplaires, dans les deux zones, les nombreuses publications du P.C.F. : journaux nationaux, régionaux et locaux ; diverses revues et brochures. Le tout représente en moyenne la moitié de l’ensemble des publications.

Imprimerie Défense de la France
Au total, la presse clandestine qui se développe dans les deux zones joue un rôle essentiel dans la Résistance (les Allemands ont même recours à de faux numéros afin de déconsidérer la Résistance !). À ce titre un hommage doit être rendu au souvenir d’André BOLLIER (X1938), surpris dans son imprimerie à Lyon et assassiné par la Milice en juin 1944.
LA VIE QUOTIDIENNE

Je vous pose la question : celui qui, une nuit, a ouvert sa porte au cycliste traqué, ou cette employée de mairie, providence des évadés, ou encore ce jeune couple abritant pendant une année la jeune Juive échappée à la rafle, et tant d'autres, des milliers et des milliers de ces bricoleurs de l'héroïsme ont-ils droit à l'appellation contrôlée de résistants ?
Les petites gens habitués à la vie d'atelier où tout naturellement un coup de main ne se refuse pas, n'avaient que la ruse à opposer à une force colossale. La belle affaire ! Au hasard des circonstances certains se sont trouvés embarqués dans de grandes épopées, mais restons dans le mode mineur où, remuant les souvenirs, je retrouve pêle-mêle un chauffeur des PTT, un typographe, un peintre, et un concierge.
Celui-là, chaque fois que je passe devant la porte de sa loge fermée définitivement, me revient le souvenir de son installation. Vous n'éviterez pas ma petite histoire. Je vous la raconte rapidement pour ne pas vous faire perdre du temps. Vous allez voir, c'est simple comme le théâtre de Guignol.
Donc à l'aube d'un beau matin, si l'on peut dire, de 1942, le voici prenant possession du local minuscule et immédiatement se mettant en mesure d'en faire un espace fonctionnel comme une cabine de bateau. C'est qu'il lui fallait caser la cage à serins et une quantité de tiroirs pleins de tire-bouchons, d'épluche-légumes et de toutes sortes d'accessoires ménagers.

Commence alors un bricolage intensif et sonore. Les choses, parfois réglées de façon supérieure, font alors qu'apparaissent deux tractions noires à roues jaunes qui s'arrêtent devant l'immeuble. En descendent des imperméables gris-vert, des chapeaux de feutre et un nombre équivalent de sales gueules. Pour un début, c'était tout de suite le grand bain. Arrêtons-nous un moment. Il en fallait davantage pour troubler notre concierge tout neuf.
La vie l'avait habitué aux torgnoles. De la guerre de 1914-1918, il disait : (En effet, un beau KO) qui l'avait laissé sanguinolent dans la gadoue. Un vrai chiendent, il en revient. Reprend son métier de relieur-doreur, un as, un peu plus tard, 1936, élu par acclamation délégué d'atelier.
L'ordre revient donc, viré comme un malpropre - liste noire-on vous écrira-le temps d'apprendre à vivre-se retrouve emballeur - utilisation des compétences-et vient l'étape où nous le retrouvons avec son marteau. Revenons à nos chiens. Beaucoup d'appartements étaient abandonnés. De tout foutre en l'air, même pour des spécialistes, cela prend du temps. A midi, la tornade verte redescend.
L’entrée de l'hôtel Meurice occupé par les officiers allemands étaient placées deux sentinelles en armes. Quand un officier entrait ou sortait, l'un des deux robots -impossible de déceler lequel-, émettait un bruit comme une fuite d'air comprimé.

Alors les deux mécaniques se déclenchaient en une gesticulation raide qui probablement représentait les signes extérieurs de respect. Les cyclistes passant devant l'hôtel étaient tenus de mettre pied à terre. Les distraits ou les indisciplinés, rappelés à l'ordre par nos gardiens de la paix, suivant les instructions de la Wehrmacht, devaient se soumettre à une vérification d'identité.
Après le bombardement de la Chapelle, les habitants du quartier venaient chercher refuge dans les plus profondes stations de métro. Pendant quelques jours la station Lamarck-Caulaincourt a été considérée comme l'abri idéal. Dehors, les chefs d'îlots ne badinaient pas.
Dès les premiers hurlements de la sirène, tout passant était vigoureusement invité à disparaître dans les sous-sols. C'est ainsi que mon copain et la jeune fille dont il venait de faire la connaissance chez des amis communs ont été confiés à la bonne garde de messieurs Lamarck et du général Caulaincourt.
Ce soir-là, l'alerte n'en finissait pas, heureusement qu'à côté d'eux, assis sur la même marche d'escalier, un vieux Montmartrois rigolard leur a raconté ses souvenirs du Lapin Agile. Fin d'alerte. La situation devenait délicate, cette exhumation coïncidait avec l'heure du couvre-feu, donc interdiction de circuler.

Le vieux les a pris sous sa protection. Il n'allait tout de même pas laisser cette belle jeunesse dehors. D'ailleurs, il demeurait à deux pas. Comme la chose la plus naturelle du monde, il leur a donné la meilleure chambre et de façon si généreuse, si engageante, que nos deux jeunes n'ont rien osé dire. Par timidité les voici dans de beaux draps, et là tout naturellement comme il est dit dans la Bible, ils se sont connus. A l'aube, désarroi de la petite, et nobles promesses du garçon. En effet, ils se sont mariés. Hélas ! Leurs caractères ne s'accordaient pas ! Ils furent très malheureux et n'eurent pas d'enfants.
LA LIBÉRATION DE PARIS

Porteurs de paniers à bouteilles, des jeunes gens sortaient du Collège de France. La grille était ouverte, décidément ce jour-là était exceptionnel. Il suffisait de traverser la cour puis de prendre un couloir et on se trouvait dans un laboratoire de chimie au milieu duquel un professeur et quelques élèves remplissaient des bouteilles. Les opérations s'effectuaient avec un bel entrain. C'était la première fois où je voyais régner dans un labo de chimie un climat qui rappelait la préparation de fête des Beaux-arts.
Donc après un remplissage, les bouteilles soigneusement bouchées étaient roulées dans un papier d'emballage préalablement enduit de colle et saupoudré de granulés blancs. Avec une grande amabilité le professeur a tenu à me montrer l'excellence de ses mélanges.
Au centre d'essais, une arrière-cour jonchée de débris de verre, sur un mur affecté à cet usage, le professeur a lancé une bouteille emmaillotée: explosion étouffée, nuage de fumée grise et ruisseaux de feu. La clientèle pouvait ainsi juger du bon fonctionnement du produit.
Avec deux copains de rencontre chargés de casiers à bière garnis desdites bouteilles, nous avons descendu la rue Saint-Jacques jusqu'à l'hôtel Notre-Dame. Au deuxième étage, une fenêtre ouverte sur le quai Saint-Michel était un poste idéal pour le jeu de massacre.

Ce même hôtel Notre-Dame, Blaise Cendrars en avait parlé dans un de ses bouquins, pour évoquer des rencontres amoureuses. A part quelques fausses alertes, le temps pendant lequel j'y suis resté ne m'a rien laissé de comparable.
Un F.F.I. en barricade à Saint Germain août 1944. Ensuite je ne sais plus s'il s'agit d'un souvenir réel ou la trace d'un mauvais rêve. Je ne le situe pas au pied de cet hôtel mais plutôt vers le quai des Grands-Augustins.
Je veux la chasser de ma mémoire mais elle revient toujours, cette vision de la voiture brûlée avec à l'intérieur quatre fantômes carbonisés, tordus, terrifiants. Pour rien au monde je n'aurais pris cette photo, d'autres peut-être ont pu le faire.
Est-ce une divagation fiévreuse, comment savoir ?
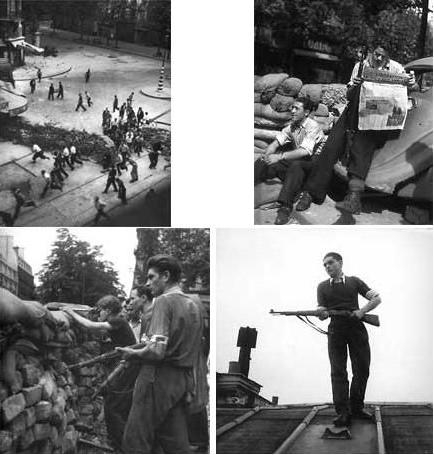
Ceux qui découvrent aujourd'hui les images de la libération de Paris peuvent émettre quelques doutes sur l'importance stratégique que pouvait avoir la barricade de la rue des Panoyaux.
Plutôt que de pratiquer une ironie facile, il vaut mieux chercher à comprendre comment les Parisiens avaient été amenés à prendre l'initiative de s'offrir enfin quelques jours de fête. Construire une barricade c'était accomplir ensemble les gestes qui allaient exorciser les mauvais jours.
Il y avait dans l'air une explosive envie d'être heureux qui rendait bien jolies toutes les femmes faisant la chaîne pour apporter aux castors de l'insurrection les gros pavés cubiques. Avec le sac de sable estampillé DP, défense passive, le pavé reste le matériau de base, bien sûr les épluchures de bitume peuvent servir à masquer quelques intervalles.
Mais on peut leur préférer le tonneau rempli de terre qui quoique traditionnel apporte une solidité qui a fait ses preuves en d'autres temps. D'autres forteresses étaient résolument métalliques, avec camions renversés offrant la protection de leurs blindages devant lesquels le gracieux feston des grilles d'arbres alignés apportait un élément décoratif.

L'armement des combattants était aussi composite que leurs citadelles. De quelles cachettes étaient sorties toutes ces pétoires? Comment étaient arrivés là ces fusils allemands, ces grenades à manche, ces mitraillettes Sten ? Mystère.
Et même si le guerrier n'avait au poing qu'un modeste 6,35, la bande de mitrailleuse portée en baudrier le désignait invulnérable. Tout en pédalant, pédalant, de Saint-Michel à Belleville et de Ménilmontant aux Batignolles, j'ai pu constater que comme les champignons les barricades poussent toujours dans les mêmes endroits. Curieusement, le terrain de Passy ou de la plaine Monceau ne paraît pas leur convenir.
Dans ces quartiers le sol doit être complètement dépourvu de ces spores nécessaires aux éclosions spontanées. La nouvelle avait été transmise par téléphone au PC de presse improvisé dans un appartement de la rue de Richelieu. Tout en pédalant, j'imaginais le spectacle.
Un chapelet de wagons disloqués, une locomotive fumante couchée sur le côté. J'accélérais l'allure, même dans les côtes. Le rendez-vous avait été fixé dans un bistrot devenu PC du côté de la rue Sainte-Marthe il me semble. Je me souviens très bien de l'effervescence. Un des chefs m'a confié à deux volontaires qui n'étaient pas chefs. Nous avons grimpé la rue des Couronnes, glissade vers la gare de Ménilmontant. Déception, adieu la belle catastrophe ferroviaire.
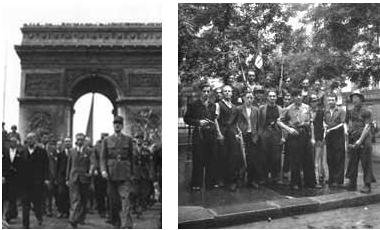
Le déraillement se situait à plus de cent mètres de l'ouverture du tunnel menant aux Buttes-Chaumont. Arrivés sur place, c'était le noir bon teint, au toucher on pouvait constater que le train marchait à côté de ses rails, voilà tout.
Retour à la lumière et roue libre rue des Couronnes, vers le métro Belleville nous avons retrouvé quelques FFI baladeurs, suffisamment nombreux pour faire un groupe genre photo de noces ! Je n'y croyais pas trop à cette photo. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, avec le temps elle me plaît bien.
L’IMPRIMERIE CLANDESTINE DES FTPF DU LOT
Dans un petit chemin forestier des environs de Latronquière un monstre ruisselant de soleil avance lentement. C’est un gros camion des FTPF chargé d’un pesant matériel d’imprimerie : massicot, pédale, moteur électrique, cases, stock de papier, boites d’encre. Arrivé au hameau de Malbouyssou, dont les maisons se cachent au milieu des bois, il s’arrête devant une masure entourée par des ronces. On pousse une porte branlante ; le plancher aux poutres écartées, laisse entrevoir la cave, c’est pourtant là qu’il va falloir installer les machines.
Tout est bientôt en place. Dans la pénombre de la première salle le massicot et la pédale luisent. La seconde salle est occupée par les rames de papier blanc, rose, vert, jaune, bleu, orange. De grandes feuilles tricolores, format colombier, attendent les caractères gras qui annonceront bientôt les manifestations du 14 juillet, puis, plus tard, la libération du département et la libération de Paris, lorsque le peuple de la capitale aura chassé, quelques semaines plus tard, le boche pris au piège.
Avec tout ce matériel, le lieutenant Marcenac, dit Walter, avait amené Lucien, ouvrier typographe de Figeac, qui, abandonnant sa femme et ses deux enfants, venait se battre au Maquis sans mitraillette et sans grenade, mais avec ses armes : les petits caractères de plomb. Désormais, au travail !
Des journaux seront bientôt envoyés dans toutes les formations F.T.P.F. de la région du Lot. Des tracts rédigés par Roland, jeune étudiant alsacien israélite, licencié en allemand, seront lancés devant les troupes de la Wehrmacht. Michel, chef militaire du P.C. régional, en écrit pour ses camarades russes encore détenus par les officiers d’Hitler.
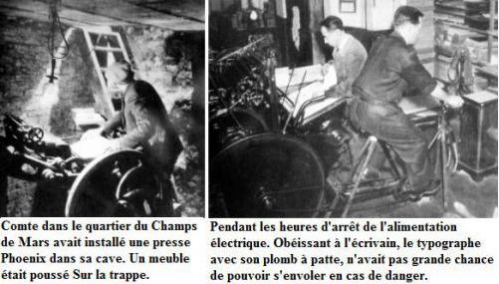
Bien des fois, les textes sont apportés dans la nuit ; Lucien se lève en hâte, une bougie éclaire les cases, et peu à peu, les caractères, les phrases, se forment, les articles sont composés. Alors Carmen, qui, poursuivie par la Gestapo, a été obligée de quitter son service d’agent de liaison, va les imprimer. Le moteur électrique est mis en marche, et, dans l’ombre, le bruit régulier de la pédale reprend sa complainte.
Le jour, il faut faire attention. Une colonne ennemie peut circuler sur la route voisine, le ronronnement des machines pourrait lui donner l’éveil. Qu’adviendrait-il alors des granges, du bétail et des récoltes des fermes environnantes ? Qu’adviendrait-il surtout des braves paysans : Sainte-Marie, maire de la Bastide-du-Haut-Mont, résistant de la première heure, hôte des premiers Maquis, Bousquet, ancien combattant, mutilé en 1917 sur le front de l’Aisne, qui ont recueilli les imprimeurs ? Car la guerre n’est pas terminée dans la région. Pendant la dernière semaine de juillet, l’alerte est donnée dans tous les secteurs. Les troupes nazies veulent remonter vers le Nord et le long des routes les détachements des F.F.I. se mettent en embuscade. La Gammon, grenade antichar, est légère dans la main du Franc-Tireur.

Malgré la guerre, qui, tous les jours détruit les villages, incendie des fermes, frappe des camarades au combat en plein front, le premier numéro du Partisan, édité sur les presses clandestines de l’Imprimerie F.T.P.F. de la région du Quercy, paraît à l’occasion du 14 juillet. Il apporte au Maquisard des échos de la Révolution française et des manifestations de notre fête nationale, commémorée malgré la présence des occupants, à Figeac la ville aux 800 déportés, à Gourdon en deuil où l’on pleure encore les otages assassinés par les nazis, à Bagnac et à Saint-Céré, à Payrac et à Souillac, à Martel, à Bretenoux. Le Maquisard du nord a ainsi des nouvelles du secteur sud : ses camarades des environs de Cahors ont célébré militairement ce 14 juillet d’espoir qui est encore un 14 juillet de guerre, ils ont détruit des routes autour de Cahors, ils ont attaqué le boche.

Quelques titres de la presse clandestine.
Le Front National, installé à la Source Salmière, puis dans Alvignac même, fait aussi paraître son journal clandestin La Liberté. Les troupes allemandes sont toujours à Cahors. Des convois traversent Figeac, Saint-Céré, Gourdon, Souillac, des avions à croix gammée survolent encore la campagne, mais la parole des vrais Français atteint ceux qui espèrent, ranime la confiance de ceux qui luttent, renforce encore celle des meilleurs ; le message du Général de Gaulle est diffusé aux habitants des communes libérées du Lot. On leur explique le rôle des Comités locaux de Libération, expression populaire du Gouvernement provisoire de la République ; il définit les tâches essentielles du Front National ; on leur transmet les résultats pratiques des décisions prises par le Comité départemental de la Libération au sujet du ravitaillement et des réquisitions. On leur annonce que le 20 août sera une grande journée de solidarité patriotique.
Enfin, c’est Jean Lurçat, dit Jean Bruyères, directeur de la Presse, qui traverse rapidement la route Nationale 20 où les Allemands passent toujours. Il va à Gourdon faire imprimer Les Etoiles, organe du Comité national des intellectuels, qui, plus que jamais, sont au service du peuple en armes. Ce journal, s’adresse plus spécialement aux étudiants, aux instituteurs, aux professeurs, aux artistes F.T.P.F., à tous les intellectuels résistants. J’ai vu Jean Lurçat, cahoté sur le porte-bagages d’une motocyclette ; j’ai vu le mécano, la mitraillette en bandoulière, conduire l’artiste qui portait à l’imprimerie des F.T.P.F. des œuvres d’Éluard, d’Aragon, de Moussinac, de Vercors. Le peuple français est en armes, tout le monde dans le circuit.

Le 4 octobre 1943 fut distribué le premier journal clandestin de la résistance du Lot : Le Lot résistant.
Dès que les tirages sont terminés, une voiture va chercher les exemplaires du Partisan et de La Liberté au Malbouyssou, puis les emporte au Château de l’Alzac, où est installé le P.C. régional depuis plus d’un mois. De là, l’équipe des agents de liaison motocyclistes, les Moutards, comme les appelle Michel, va les répandre au secteur A, chez Coujoux, installé à Gluges, chez Emmanuel (mort pour la France en allant libérer Toulouse), commandant le secteur B, établi à la Gineste. Des P.C. de secteur les journaux sont répartis dans les bataillons, les compagnies et les sections. Chaque Franc-Tireur aura son journal. Les Libertés sont déposées chez le Responsable du F.N., les paysans et les artisans des campagnes, les intellectuels et les ouvriers des petites villes déjà libérées ne sont pas oubliés. Tous les Français résistants reçoivent des informations exactes sur la situation et des mots d’ordre pour continuer la lutte jusqu’à la libération totale.
En effet, totalement isolés dans les bois, menant la vie des traqueurs ou des pionniers de quelque Far-West disparu, en état d’alerte perpétuelle, les chars allemands rôdant encore sur les routes, les jeunes combattants de la Liberté sont bien informés. Car ce n’est pas un torchon de Vichy qui, se glissant dans les taillis, vient leur raconter des histoires et des mensonges, c'est un journal, une petite feuille au format très réduit.
Certes, mais un journal créé pour eux, écrit par des camarades de combat, imprimé dans une chaumière délabrée qu’ils protègent. Tous les mots du Partisan, de La Liberté et des Etoiles, sont des mitraillettes, des fusils et des grenades. Tous les mots des journaux clandestins sont des armes dans la tête et dans le cœur de celui qui, chaque matin, à son réveil, chante face au soleil levant : Je suis vainqueur !
L’imprimerie de la Résistance
Il faut encore évoquer les services annexes que le temps nous permit de mettre sur pied. Ainsi se posa très tôt le problème d'une imprimerie du maquis. Nous avions longtemps travaillé grâce aux seules machines à écrire, le tirage stencil nous permettant de multiplier les instructions. Puis, un jour, la nécessité de disposer d'un journal de liaison rendit impérative l'installation d'une imprimerie à nous. Comment faire ?
Nous avions appris à prendre les choses là où elles étaient. Il fut décidé de déménager une imprimerie. On en choisit une à Figeac et je chargeai Jean Marcenac (capitaine Walter) de régler l'affaire.

L'imprimerie clandestine installée chez Monsieur Sainte-Marie, maire de Labastide du Haut-Mont.
Deux camions, une voiture légère, des gars résolus et bien équipés : Marcenac réussit sans trop de peine à monter son coup et le matériel nécessaire atterrit un beau matin dans une ferme écartée de Labastide-du-Haut-Mont, chez le maire Sainte-Marie.
Le problème n'était pas résolu pour autant : manquait encore le technicien qui ferait tourner la machine. Nous n'avions d'autre choix que de capturer l'imprimeur. Marcenac partit à nouveau en mission et ramena donc le bonhomme qui devint l'imprimeur clandestin du maquis, en quelque sorte un résistant contraint et forcé comme il y en eut pas mal. Nous fîmes courir le bruit, afin d'éviter les représailles, que le maquis avait emmené de force le malheureux.
On n'eut plus désormais qu'à fournir de la copie à ce nouveau collaborateur bénévole. Nous ne manquions pas de matière, entre nos informations propres et la littérature du Front national, et c'est ainsi que s'imprimèrent dans le Lot, Aragon et Jean Lurçat, Éluard et Vercors, et tant d'autres poètes de la nuit. Ainsi fut fondé le journal Le Partisan qui fut, en même temps qu'un organe de liaison, un organe de propagande. Les premiers numéros du Partisan étaient ronéotypés sur une seule face, puis ils le furent recto-verso en 21 x 27 avant d'être imprimés.
A la Libération, on ramena l'imprimerie à Figeac, puis quelque temps après on fit imprimer le journal sur les presses de Cahors.

Plus au nord, dans les forêts du Ségala, non loin de Latronquière, le lieutenant Marcenac des FTP dirige une imprimerie du maquis de juin à août 44, aidé par le peintre cartonnier d'Aubusson, Jean Lurçat. Il emploie des typographes professionnels de Figeac. Un jeune étudiant juif d'alsace traduits les tracts FTP en allemand et les dépose sur les routes fréquentées par la Wehrmacht. Pour le premier numéro de Partisan, publié le 14 juillet 1944, Lurçat apporte des œuvres d'Éluard, d'Aragon et de Vercors à composer à l'imprimerie des bois. En octobre 1944 Les Etoiles du Quercy déclare devoir son origine à cette presse du maquis et souligne le rôle local du texte imprimé dans la transmission des ordres de commandement des FTP aux maquis du Ségala : Totalement isolés dans les bois, et menant une vie de pionniers traqueurs dans une saga du Far West, les jeunes combattants de la liberté sont en permanence tenus informés par la presse.
Les Etoiles du Quercy, est une revue fondée à Cahors (7 rue de la Préfecture, puis 12 rue Wilson) par Jean Lurçat, le commandant Rémy (1) et Jean Agamemnon, et dont le premier numéro porte la date d'août-septembre 1944 et a pour titre Numéro de la Libération. Cette revue n'est pas en soi totalement nouvelle, puisqu'elle fait suite à Quercy, revue autorisée par Vichy, ayant paru entre décembre 1941 et octobre/novembre 1943, et qui saluait ouvertement le Maréchal. Son ancien rédacteur, Joseph Maureille, semble néanmoins proche du groupe formé par Jean Lurçat, puisqu'il devient secrétaire de rédaction de la nouvelle revue. Cette revue, se présente comme une tribune dans laquelle s'expriment des écrivains d'origine quercynoises ou liés au Quercy par le combat soutenu sur son sol. Les collaborateurs à la revue sont des résistants actifs, ou qui ont lutté, travaillé, effectué des missions dans le département du Lot, et qui peuvent donc aujourd'hui porter la parole de pays. Par ailleurs, la revue est placée sous le patronage d'honneur comporte les noms de martyrs de l'action résistante : Jacques Decour, Saint-Pol Roux, Georges Politzer, Max Jacob, Antoine de Saint-Exupéry, Maurice Jaubert, Hoogh.
Cette revue ne paraitra cependant que trois fois, avant de disparaitre en janvier 1945.
Le premier numéro se consacre à la Libération, avec des articles de Jean Cassou, Léon Moussinac, André Chamson, René Huyghe, Jean Marcenac et des contributions signées Paul Éluard ou Aragon. Le second numéro d'octobre 1944, présente entre-autres, un portrait d'Antoine de Saint-Exupéry par René Kerdyk, une étude de Jean Lurçat sur les intellectuels dans le Quercy, un témoignage de Pierre Mazars sur Cahors libéré, un article de Noël Baillif sur l'imprimerie clandestine des FTPF du Lot (Article reproduit ci-dessus). Le troisième et dernier numéro, paru début 45, présente une lettre inédite de Marcel Proust, des contributions dont certaines déjà publiées dans la clandestinité, de Charles Vitrac, Paul Éluard, Jean Paulhan, Jean Lurçat, Maurice Fombeure, Jean Marcenac, Tristan Tzara, Léon Moussinac, Luc d'Estang, Pierre Mazars, etc.
Jean Lurçat résistant lotois
Simone Lurçat (née Selves), épouse de Jean Lurçat, a raconté le travail et l’œuvre de celui dont elle partagea la vie à partir de 1944. Son ambition pour l’art de la tapisserie, son rapport aux autres, son goût du travail collectif. Elle évoque sa rencontre avec lui, dans le Lot, au cœur du maquis et les années heureuses passées à Saint-Céré où Jean Lurçat avait construit un atelier à sa dimension, dans sa propriété des Tours Saint-Laurent. En août 1941, Jean Lurçat quitte Aubusson et, après un très bref séjour à Collioure, se réfugie dans le Lot où il s'installe à Lanzac en 1942. Rapidement associé au combat de la résistance, son engagement l'amène à changer fréquemment de lieux de résidence : le Château de Grézols à Saint-Cirq Lapopie, Lanzac, Souillac. En 1944, il est nommé membre du comité de Libération du Lot et est chargé du travail d'organisation dans le secteur Souillac Alvignac Saint-Céré Figeac. Il dirige le journal Liberté et la revue Les Etoiles du Quercy. C'est au cours des opérations clandestines qu'il rencontre sa future épouse, Simone, et découvre les Tours de Saint-Laurent. En septembre, après avoir participé à la libération de Cahors, il devient directeur des Services culturels du département.
La presse clandestine

Presse officielle national-socialiste dans la région du Rhin-Supérieur : propagande parue en dernière page de l’Oberrheinischer Heimatkalender 1943.
Pendant la nuit de l'oppression, la presse clandestine. Allocution de M. Pierre Schmitt, Conservateur de la Bibliothèque.
A l'occasion de l'ouverture de l'exposition La Presse clandestine le 1er décembre 1945, au Foyer du Théâtre Municipal de Colmar, M. Pierre Schmitt, Conservateur de la Bibliothèque, a prononcé une très belle allocution dont voici quelques passages exaltant l'œuvre magnifique de la presse clandestine en France pendant l'occupation.
Est-il besoin de vous rappeler ici l'époque terrible où la France, désarmée, impuissante, brimée par l'ennemi et les valets à sa solde devait assister à l'emprise toujours plus grande de l'occupant ? Mais, sûr de sa puissance, une fois encore celui-ci a manqué de sens psychologique et bientôt les Français qui avaient non pas frôlé l'abîme, mais qui y avaient été littéralement précipités sous le formidable coup de boutoir des masses germaniques, se ressaisirent, se mirent debout, et s'armèrent, les uns de mitraillettes qui leur venaient du ciel, les autres de la plume, arme non moins redoutable dans une guerre moderne. Aujourd'hui, les uns comme les autres pleurent d'innombrables camarades, morts dans l'anonymat du combat clandestin.
On se penchera donc avec émotion sur ces journaux d'apparence modeste, sur ces tracts, sur ces minuscules papillons, imprimés dans quelque cave obscure avec des moyens de fortune, et involontairement nos pensées vont vers ces admirables ouvriers typographes qui, privés de toutes ressources matérielles et tout simplement munis d'une presse à bras, ont trouvé le moyen de faire sortir une véritable avalanche d'imprimés clandestins. On ne trouvera pas moins étonnants ces pauvres feuillets hectographies, ou tirés à la ronéo, ces journaux tapés à la machine, ou encore ce splendide album, exemplaires numérotés et tirés sur papier de luxe, qu'éditèrent les peintres français, quelque part en France, au 48e mois de l'occupation allemande.
Quelle vitalité, quelle force, quelle révolte aussi dans tous ces papiers ! Et puis, n'est-t-il pas émouvant de constater la persévérance, l'acharnement, la farouche énergie de ces lutteurs, comme aussi la haute portée morale de leurs écrits ? La souriante malice de chez-nous ne perd pas ses droits et les flèches acérées décochées à l'adresse de l'envahisseur sont innombrables. Il faut lire ces journaux ; il faut lire ces tracts, il faut lire ces feuillets uniques de papier fragile et de nuance changeante, où s'affirme tant de courage et tant de patriotisme.
Pour l'Alsace, les émotions que nous avait apportées la presse clandestine pourraient être d'une poignante nouveauté. Mais l'Alsace, elle, n'a-t-elle pas tenté d'exprimer les sentiments qui bouillonnaient en elle et l'oppressaient si douloureusement ? L'Alsace est-elle restée à l'écart ?
Non, notre Alsace, malgré son isolement tragique, a élevé sa voix. De Strasbourg nous est venu le "Manifeste des six fusillés" et le Journal libre avec ses violentes attaques contre les maîtres de brun vêtus ; du Haut-Rhin, les tracts de Charles Murbach et de ses camarades ; de Toulouse le beau fascicule du Témoignage Chrétien réservé aux Terres françaises que sont l'Alsace et la Lorraine; de Londres, d'Alger, d'Oran, des pages poignantes qui sont autant de protestations contre l'annexion arbitraire de nos provinces. Tous ces écrits, d'éloquente manière attestent la présence de nos compatriotes partout là où l'on se battait.
Partout là où l'on se battait ! Et c'est pour cela que nous n'avons pas voulu terminer cette exposition sans y avoir fait figurer ceux de nos compatriotes qui s'étaient armés à la fois du fusil et de la plume pour combattre l'éternel envahisseur, j'ai parlé de la Brigade Alsace-Lorraine dont les vertus morales et guerrières ont si magnifiquement éclaté durant toute la guerre de la libération.
Les journaux et les tracts que vous verrez sont tachés de sang. Des aviateurs qui les ont lancés sont morts en service commandé. Des intellectuels, des journalistes, des propagateurs sont morts au poteau d'exécution. Pourchassés par la police, traquée par la Gestapo, leur rang accuse de nombreux martyrs. Et ce n'est pas sans un serrement de cœur que je puis songer à ce médecin bourguignon assassiné par les Allemands pour avoir été le propagandiste acharné du cahier Alsace et Lorraine, terres françaises !, ou à cet humble typographe, lui aussi fusillé dans l'aube pâle d'une matinée parisienne et dont la veuve éplorée disait à ses enfants : Pour que la France vive, il faut des héros ; soyons fiers que le Bon Dieu ait choisi notre papa.
Paroles d'une grandeur sublime ! Un pays qui appelle sienne de telles femmes, et sienne une telle jeunesse, ne peut pas mourir ; il est prédestiné pour le combat de l'amour que seul pourra nous rendre un monde vraiment plus fraternel.
LA COMPLICITE DES COLLABORATEURS
Lorsqu’au contrôle du Danemark, l’Allemagne ajoute, en avril 1940, l’occupation de la Norvège, un ancien ministre norvégien de la défense et sympathisant nazi, Vidkun Quisling (ci-contre), prend la tête d’un gouvernement de collaboration. Son nom deviendra un symbole, puis une insulte : Quisling !
En Yougoslavie, la grande Croatie, en théorie indépendante, est dirigée par les Oustachi dont le chef, Ante Pavelitch, instaure un régime de terreur, surtout envers les Juifs et les Serbes.
La France a, dans l’Europe de l’Ordre Nouveau une place à part. Le 24 octobre 1940, Pétain, persuadé de la victoire de l’Allemagne, rencontre Hitler à Montoire (ci-contre) et engage la France dans la voie de la collaboration avec l’Allemagne.

Entrevue de Montoire le 24 octobre 1940, entre Hitler et Pétain, à l’arrière von Ribbentrop ministre du Reich
Le maréchal fait arrêter Laval, le 13 décembre 1940, mais le retour de ce dernier (qui n’hésite pas à proclamer : (Je souhaite la victoire des Allemands) est imposé par les nazis au printemps 1942. La France, dès le début, s’engage dans une collaboration politique, économique, militaire et policière.
Les ultras de la collaboration (Jean Bichelonne, Fernand de Brinon (ci-dessous), Joseph Darnand, Louis Darquier de Pellepoix, Marcel Déat, Jacques Doriot, Philippe Henriot, Jean-Hérold Paquis, René Bousquet, Paul Touvier, pour ne citer que les principaux) sont nombreux.
Cette collaboration va être d’autant plus efficace dans le domaine de la répression que les ennemis désignés par l’un et par l’autre sont essentiellement les mêmes, dès 1940.
Grâce aux moyens répressifs mis en place (notamment l’internement par mesure administrative, c’est-à-dire par décision du préfet et non après jugement), l’Etat français va pouvoir envoyer dans les camps d’internement, créés à cet effet, tous ceux qu’il entend mettre à l’écart de la société française.
Ainsi, à l’été 1940, retrouve-t-on, dans les camps français de la région des Pyrénées (Gurs, Argelès, Le Vernet, Noé), surtout des réfugiés politiques, à savoir des républicains espagnols (envoyés en plusieurs vagues à Mauthausen : 6784 sur 9067 y sont morts), des combattants, notamment allemands et autrichiens, des Brigades Internationales, livrés par Pétain, des communistes (dont le parti a été interdit le 26 septembre 1939).
Par la suite, l’Etat français durcit la législation déjà existante, en aggrave l’arbitraire et élargit le cercle des victimes à tous les opposants (communistes, gaullistes, résistants de tous bords) et aux Juifs (en octobre 1940, les Juifs étrangers, puis, à partir d’août 1941, l’ensemble des Juifs).
Ainsi, sans qu’aucune pression allemande ne soit nécessaire, les autorités françaises rassemblent dans les prisons ou dans les camps ceux dont l’occupant va entreprendre la destruction.

C’est le gouvernement de Vichy qui crée en août 1941 et administre, sous la haute autorité des SS, le camp de Drancy, véritable antichambre d’Auschwitz, d’où partent 67 des 79 convois de Juifs déportés. C’est de l’autre plaque tournante qu’est Compiègne que le coup d’envoi est donné avec le convoi du 27 mars 1942 (1.112 personnes déportées dont seulement 19 survivent en 1945).
Ralf du Vel’ d’Hiv’ 16 juillet 1942
De même, ce sont surtout les policiers français qui arrêtent les résistants ou qui opèrent la plupart des rafles, notamment celle du Vel’ d’Hiv’ qui, le 16 juillet 1942, voit l’arrestation à Paris et en région parisienne de près de 13.000 Juifs (hommes, femmes, enfants). Comme on le voit, l’Etat français est donc une courroie essentielle dans le mécanisme du génocide.
La déportation des Juifs dont Serge Klarsfeld a recensé, pour la période du 27 mars au 11 novembre 1942, 45 convois emmenant 41.951 personnes (notamment 4.000 enfants) s’accélèrent. A la Libération, seulement 691 hommes et 21 femmes ont survécu, mais pas un seul enfant.
La résistance, elle aussi, est concernée par la déportation qui représente un des multiples moyens utilisés par l’Etat français qui a mis en vigueur le système des otages, pour liquider les résistants jugés particulièrement dangereux.
Ainsi, les premiers convois partis de France sont des convois de représailles, constitués essentiellement de résistants comme celui qui, ci-contre, quitte le camp de Compiègne et, à partir de l’été 1941, commence l’envoi de convois importants de résistants. Ce fut le cas, notamment, du convoi des 45.000 (appelés ainsi en raison de leurs numéros de matricule).
Ce convoi des 45.000 expédie à Auschwitz, le 6 juillet 1942,1.170 hommes (essentiellement communistes et syndicalistes) dont il ne reste, à la libération, que 122 rescapés.
Dénonciation


Henri Chamberlin qui portait le surnom de Lafont
Deux auxiliaires de la Gestapo ont laissé le plus sinistre souvenir : Bonny et Lafont. Henri Chamberlin, dit Lafont ( à droite ), né en 1902, plusieurs fois condamné pour vol et abus de confiance, interdit de séjour, réussit le tour de force de monter sous un faux nom un commerce prospère et de devenir un mécène de la police, gérant du mess d'une amicale de la Préfecture de Police. Son identité est découverte en avril 1940. Écroué, libéré par la défaite, il se met au service des Allemands. Peu à peu, installé rue Lauriston, il se rend indispensable à Otto, à la Gestapo, à nombre de personnages français et allemands. D'abord indicateur, puis chef d'équipe pour le compte de la Gestapo, il monte un groupe d'individus, en majorité criminels, escrocs, souteneurs qu'il a fait libérer de prison et s'associe en mai 1941 avec l'ex-inspecteur de police Bonny, celui que le ministre Cheron avait jadis appelé le meilleur policier de France.
L'équipe Bonny-Lafont vit graviter autour d'elle un monde étonnant de dévoyés, de désaxés, de prostituées de haut vol. Elle pratiqua le marché noir à grande échelle, le trafic d'or et de bijoux volés ou empruntés de force aux juifs. Elle procéda à de vastes pillages. Elle mena grande vie, dépensant sans compter ; elle eut autour de soi une véritable cour. Travaillant en liaison étroite avec la Gestapo, Bonny et Lafont firent des locaux de la rue Lauriston et de la place des États-Unis de terribles lieux de souffrance. C'est Bonny qui orienta la bande vers la chasse aux résistants et aux maquisards. Ils démantelèrent le réseau Défense de la France dont faisait partie Geneviève de Gaulle, nièce du général, qu'ils arrêtèrent. L'équipe commit des meurtres crapuleux, pratiqua le chantage aux personnes traquées, fit défiler dans ses chambres de torture des dizaines de patriotes, s'occupa de lever des mercenaires pour combattre le maquis (ainsi, la légion nord-africaine). Grâce à la tactique qui consiste à « mouiller » les gens, à des générosités intéressées, à leur fortune, au bagout de Lafont et à la sympathie qu'il pouvait inspirer, les deux compères surent avoir des relations partout et même avec de hautes personnalités. Beaucoup, parmi elles, les fréquentaient pour en obtenir non pas forcément des faveurs alimentaires, mais des libérations d'amis. Car les truands interrompaient pillages, tortures, meurtres, pour, de temps à autre, sauver quelque inculpé, rendre des services, ce qui en fait leur assurait des tolérances ou des soutiens.
Le recrutement dans la Milice en temps d’occupation allemande
Les victimes des auxiliaires français de la Gestapo ouvrent la longue liste des tués par règlements de comptes. La police allemande confie, en effet, au M.N.A.T. (Mouvement National Anti-terroriste) les exécutions auxquelles elle répugne. Enlevés de nuit, les malheureux sont emmenés en voiture et tués d'une balle dans la nuque le long d'une route. Le lendemain, un promeneur matinal découvre un cadavre avec un écriteau sur sa poitrine : Terreur contre terreur. Ainsi sont assassinés, à Lyon, le président de la Ligue des droits de l'homme, Victor Basch, et son épouse. Le même scénario se répète, à quelques variantes près, dix fois, vingt fois, des centaines de fois. La Gestapo eût-elle été aussi efficace sans le concours des agents français (indicateurs, tortionnaires, anciens maquisards retournés) qu'elle employait ? Un rapport chiffré permet de donner une réponse, hélas, sans ambiguïté.

A Saint Etienne où la police allemande s'installe en janvier 1943, comme dans tous les autres chefs-lieux de départements, ses services comptent quinze nazis et trois cents Français à la solde de la redoutable organisation. A Paris, l'importance des affaires à traiter amène la Gestapo à déléguer ses tâches à d'abominables officines telles que celle de la bande Bonny-Lafont; rue Lauriston, et celle de Masuy, l'inventeur du supplice de la baignoire, opérant avenue Henri-Martin. A ces premières exécutions de patriotes, font écho celles de miliciens. Leur uniforme bleu orné du gamma d'argent ou d'or, les slogans des radios de Londres et d'Alger : Miliciens, futurs fusillés, les désignent d'autant plus aux coups des résistants qu'ils ont à peine de quoi se défendre. Méfiants à leur égard, les Allemands refusent en effet de les doter d'un armement régulier.
Avec le développement de la Résistance et l'imminence d'un débarquement en France, la Milice se voit renforcée. Début 1944, Joseph Darnand, secrétaire général au Maintien de l'ordre, proclame : La Milice française a supporté pendant cinq mois les coups des assassins sans riposter. La terreur s'est accrue. Nous nous sommes organisés pour la lutte, nous avons étendu notre réseau de renseignements, nous nous sommes armés. Nous poursuivrons sans faiblesse nos justes représailles. Que nos adversaires sachent qu'aucun de leurs crimes ne restera impuni, que nous frapperons les assassins et leurs complices. Une loi, parue au Journal officiel du 20 janvier 1944, donne effectivement à Darnand autorité pour créer des cours martiales habilitées à juger les individus agissant isolément ou en groupes, arrêtés en flagrant délit d'assassinat ou de meurtre commis au moyen d'armes ou d'explosifs pour favoriser une action terroriste . Trois membres, non magistrats, composent la cour martiale. Dans les villes où ils opèrent, on les voit descendre d'un train, au petit matin; ils prennent aussitôt le chemin de la prison où, juges anonymes, ils prononcent une sentence, la mort en général, immédiatement exécutoire. Cette parodie de justice s'exerce, la plupart du temps, à l'encontre d'une personne désignée sur une liste noire et condamnée d'avance.

Gourdins, nerfs de bœuf, ceinturons constituent la panoplie élémentaire des instruments de torture dont disposent les cours martiales qui commencent à fonctionner en février à Marseille et Toulouse, en avril à Paris. Les sévices s'exercent sans retenue aucune. Ici, lors d'une opération menée contre un maquis breton, un témoin oculaire, cité par Robert Aron, raconte : On traîne un maquisard blessé dont l'une des jambes n'est plus qu'un amas de chairs meurtries et de sang coagulé. Son visage s'est recouvert d'un masque cadavérique : pourtant les miliciens ne semblent pas encore satisfaits et lui martèlent les reins à coups de crosse de mitraillette. Ailleurs, une file de détenus face au mur. Les miliciens font un va-et-vient continu derrière eux, décochent çà et là des coups de grenade à manche, de crosse de mitraillette ou de bottes. L'un, qui a à peine vingt ans, s'acharne sur un jeune rachitique pâle et boiteux, auquel il voudrait faire adopter une attitude verticale, mais le pauvre enfant ne peu. En d'autres circonstances, les miliciens se contentent d'un rôle subalterne de croque-morts au service des bourreaux nazis.
Sanglant prélude au débarquement

Résistants et miliciens de Vichy
Début 1944, sentant croître le danger d'un débarquement allié en France, les Allemands décident de nettoyer les maquis les plus importants afin d'éliminer toute menace sur leurs arrières. Comme leurs meilleures unités sont alignées sur le Mur de l'Atlantique ou en réserve tactique, ils décident de compenser leur faiblesse numérique en s'adjoignant des auxiliaires français. C'est, bien sûr, la Milice qui fournit l'appoint nécessaire. Ainsi participe-t-elle, avant juin 1944, à la plus grande opération d'envergure qui soit montée contre le maquis : l'attaque du plateau des Glières, en Savoie. G.M.R. et miliciens, postés aux issues, assurent le bouclage du dispositif tandis que les Allemands ratissent le plateau. L'action, commencée le 26 mars, tourne rapidement à une poursuite impitoyable des patriotes; ceux qui parviennent à s'échapper par les passages menant vers les vallées tombent parfois sous le feu des francs-gardes aux uniformes bleus.
Vengeance, hasard, un mois plus tard, une effroyable tuerie ensanglante encore la région : à Voiron, dans l'Isère, le chef de la Milice, Jourdan, a pour vis-à-vis un certain Durand qui a juré sa perte. Comme Jourdan, craintif, est toujours gardé et armé, Durand imagine de faire adhérer à la Milice locale quatre jeunes gens de confiance. Ayant endormi la méfiance de Jourdan, ceux-ci viennent régulièrement chez lui pour écouter les éditoriaux enflammés de Philippe Henriot à Radio-Paris. Le soir du 20 avril, comme à l'accoutumée, ils entrent et, brusquement, dégainent leurs armes : une balle dans la nuque pour Jourdan, une autre pour sa femme, une troisième et une quatrième pour les deux gardes du corps, une cinquième pour la grand-mère hurlante d'effroi, une sixième pour le gamin de dix ans cloué par la peur, une septième enfin pour le bébé dormant dans son berceau, voilà toute la maisonnée abattue de sang-froid.
Personnalités assassinées

L'assassinat de personnalités révèle le caractère impitoyable de ces représailles qui n'épargnent personne. Ainsi en est-il de Jean Zay, ancien ministre de l'Education nationale, condamné par Vichy à la détention perpétuelle pour désertion en 1940. Enfermé depuis cette date à la prison de Riom, il en est extrait le 20 juin 1944 par trois miliciens chargés de son transfert dans le Vaucluse. A partir du moment où la voiture emmène le malheureux, on perd sa trace. L'hypothèse la plus plausible porte à croire que se faisant passer pour des maquisards, les trois individus mettent Jean Zay en confiance. Lors d'une halte improvisée, celui-ci descend de voiture sans méfiance; tandis qu'il s'éponge le front et essuie ses lunettes, l'un des tueurs l'abat d'une longue rafale de mitraillette dans le dos.
Huit jours plus tard, Jean Zay est vengé : répondant à l'ordre du gouvernement d'Alger d'enlever Philippe Henriot ou de l'exécuter, les F.F.I. remplissent ponctuellement leur mission. Secrétaire d'État à l'Information du gouvernement de Vichy, l'homme à la voix d'or, comme on l'appelle, couche ce soir-là, 27 juin, dans les locaux du ministère. Malgré les appréhensions de sa femme, il refuse les services de son garde du corps. Pour lui, la nuit sera brève : après avoir intimidé, avec de faux papiers, un piquet de gardiens de la paix, après avoir menacé la concierge, les exécuteurs menés par un certain Morlot, un dur de vingt-deux ans, montent jusqu'à la chambre du ministre : Milice ! Henriot s'approche. N'ouvre pas, hurle son épouse. Mais le ministre a déjà tourné la poignée. C'est alors la ruée. C'est bien vous Philippe Henriot ? s'écrie Morlot, braquant son revolver. C'est moi Une première balle ne fait qu'érafler la joue. A la troisième, Henriot s'affaisse. Au même moment, une rafale laboure le ventre du ministre qui pousse un grand cri et meurt sur-le-champ.
La rage au coeur, les miliciens vont chercher, plusieurs jours, une victime expiatoire. Ils la trouveront bientôt en la personne de Georges Mandel. L'ancien chef de cabinet de Georges Clemenceau, ministre des P.T.T. en 1934, puis des Colonies en 1936, avait refusé de rejoindre Londres en juin 1940, afin de subir le sort de son pays. Détenu comme otage en Allemagne, il est livré à la France le 6 juillet 1944. Le 7, en début d'après-midi, après sa levée d'écrou de la prison de la Santé, deux voitures de miliciens viennent le chercher. Destination de principe : le château des Brosses à Vichy. Les autos prennent la direction de la Porte-d'Italie. Peu après le carrefour de l'Obélisque, en forêt de Fontainebleau, les deux véhicules s'arrêtent : Panne de carburateur, déclare l'un des miliciens. Les passagers descendent pour se dégourdir les jambes. Mandel, accompagné d'un milicien du nom de Neroni, bavarde et s'enquiert des curiosités du massif forestier que son interlocuteur parait connaitre à merveille. Tout à coup, c'est le drame : un tueur débouche sur le sentier et tire une rafale. L'ancien ministre s'écroule, frappé de sept balles en plein thorax.
Exécutions sommaires à Guéret

Exécution d’otages à Guéret en 1944
A quatre cents kilomètres des côtes de Normandie, Guéret, serrée autour des murs de son église romane, connaît en ce matin du 7 juin 1944, au lendemain du débarquement allié, la griserie de la libération. Griserie d'autant plus intense qu'aucune portion du territoire métropolitain n'est alors définitivement arrachée à l'occupation ennemie et que cette délivrance est le fait des seules F.F.I., Forces françaises de l'intérieur. De bonne heure, ce jour-là, des combats ont opposé les maquisards aux Allemands, retranchés dans deux hôtels, et aux miliciens, barricadés dans les locaux de la loge maçonnique. Après un bref mais vif engagement, Allemands et miliciens se rendent : aux premiers sont rendus les honneurs de la guerre, aux seconds la vie sauve est accordée. Les lois de la guerre sont observées; pour un temps seulement, car la population enthousiaste, libérée de sa peur, s'est mise à pourchasser les collaborateurs cachés chez eux.
A mort, vendu, salaud ! entend-on hurler de toutes parts. Alors commencent les premières exécutions sommaires : tandis que le combat du matin n'a fait qu'un tué dans les rangs de la Résistance, la fusillade de la haine couche à terre une dizaine de miliciens. Mais la vengeance n'a guère le temps de s'assouvir. Le 9 juin, dans un fracas de moteurs grondants, des camions bourrés de soldats de la Wehrmacht et de miliciens réoccupent la ville en force. Ces derniers organisent une rafle monstre qui conduit les Guérétois suspects à Limoges. Interrogatoires et tortures précèdent de peu les condamnations à mort dont les sentences n'ont, fort heureusement, pas le temps d'être exécutées en raison de la débâcle allemande.
La chasse aux collaborateurs

Dans les villes, l'oppression de quatre années d'occupation, les privations endurées, la peur trouvent tout à coup leur exutoire dans l'explosion de la vindicte populaire. Château-Gontier, qui a connu, la veille même de sa libération, des heures affreuses marquées par l'exécution de sept Français (otages et résistants) fusillés dans la cour du collège à l'aube, 6 août, voit s'organiser, dès le lendemain, une active chasse aux collaborateurs. Comme le rapporte Marc Vallée : Plusieurs ont réussi à se cacher ou à s'enfuir. Les autres sont arrêtés à leur domicile ou dans les endroits les plus divers où ils ont vainement essayé de se dissimuler. Sous la menace de mitraillettes, par les rues de la ville, ils sont emmenés et emprisonnés. D'autres, attachés et en cortège, sont conduits jusqu'au lieu de la tuerie. Là, ils sont obligés d'enlever, poignée par poignée, la terre fraîche jusqu'à ce que soient mis à jour les sept cadavres. Ailleurs, quelques femmes ou jeunes filles dont la conduite fut légère avec les Allemands sont fort cruellement tondues à ras sur la place publique et leurs chevelures, ô dérision, accrochées à leurs portes.
Mais il y a aussi l'anonyme troupeau des civils innocents tués par un cruel destin : destin du châtelain jalousé, tels dans le Sud-Ouest, qui fut lardé de coups de couteau, arrosé d'essence et brûlé, ou le baron Reille-Soult, froidement tué à Montmorillon tandis que son château est pillé; et pourtant il avait fait du renseignement au profit des Anglais. Destin de l'ancien combattant, fervent pétainiste, du médecin dévoué pour qui les partis n'existent pas, destin du chef d'entreprise payant de sa vie la mise à la disposition de l'Allemand de ses usines ou ateliers. Mais on meurt encore pour moins que cela : d'une imprudence verbale, d'un rendez-vous pris avec un collaborateur notoire, d'une rencontre fortuite avec l'occupant et pour des motifs n'ayant rien à voir avec la guerre.
Les gangsters de la Libération

Partout on dénonce : les lettres anonymes affluentes. Un exemple qui donnera le climat : dans le journal France-Libre du 26 août, il est écrit : Il appartient à chaque Français de faire lui-même la police dans son immeuble et dans son quartier et de signaler immédiatement tout suspect aux autorités constituées. Malheur aux concierges ! Le fait de ne pas dénoncer, de cacher un homme en danger peut valoir à son auteur d'être étiqueté collabo. La France retrouve ses tricoteuses de la Révolution qui veulent voir du sang et des congénères humiliées. Elle retrouve ses chauffeurs qui pillent, rançonnent, torturent. Elle retrouve en certains lieux ses sans-culottes mangeurs de curés. Dans la Guyenne et le Languedoc, des prêtres sont tués l'un d'eux, en Lot-et-Garonne, eut la langue et les yeux arrachés, puis fut pendu par les pieds jusqu'à ce que mort s'ensuive. Des religieuses accusées d'espionnage sont torturées.
La collaboration eut ses gangsters et ses tortionnaires. La Résistance, à son corps défendant, en sécréta aussi. Il y eut de véritables chefs de bande, des étrangers souvent, qui terrorisèrent des cantons (comme Le Coz qui fut fusillé). Ce sont eux qui, soucieux de raffinement, ont tué des hommes sous les yeux de leur famille, exécuté parfois femmes et enfants, massacré des détenus dans les prisons, fusillé des notables comme le docteur Nourrissait à Saint-Bonnet-de-Joux qui était intervenu auprès des Allemands pour sauver des otages, comme le préfet de la Lozère ou le président du tribunal de Nîmes. Pour beaucoup, la Résistance est un paravent derrière lequel se masquent de sordides jalousies, à l'abri duquel couvent des appétits douteux : ici c'est une femme que l'on convoite, là ce sont des richesses sur lesquelles ont projette de faire main basse, ailleurs c'est un concurrent, un rival plus heureux que l'on se propose d'abattre. La vraie Résistance s'efforça de mettre à la raison toute la lie qui s'était levée. Mais dans une telle atmosphère passionnelle, froidement désirée par les communistes et indirectement provoquée par les gaullistes qui voulaient que le peuple se lève, il était difficile que, pendant quelques mois, l'exception ne fût pas de règle.
LA CHASSE AUX COLLABORATEURS
Ces tribunaux, des régions dans lesquelles ils opèrent (essentiellement l'ancienne zone non occupée) de l'intensité de l'activité milicienne dont il s'agit de se venger, des horreurs découvertes après le départ de l'armée allemande, horreurs dont les collaborateurs qui n'ont pas fui sont, à tort ou à raison, rendus responsables.
La justice du peuple en 1944
Les commissaires de la République, choisis et désignés dans la clandestinité, bien avant la Libération, pour maintenir l'ordre et jeter les bases d'une république nouvelle, ont beau prendre des arrêtés mettant fin à l'existence des tribunaux militaires ou autres cours martiales, il faut du temps, dans certains départements, pour que leurs ordres soient suivis d’effet.

Procès de collaborateurs en 1944
Sans doute la justice mettra-t-elle bien des mois avant de rentrer. Dans les voies de la légalité. Et les anomalies ne manquent pas. Ainsi les jurés des cours de justice sont-ils systématiquement choisis parmi les résistants, c'est-à-dire parmi les adversaires de ceux qu'ils ont à juger; ainsi les prévenus ne peuvent-ils se réclamer de l'obéissance à un gouvernement déclaré illégal depuis le 16 juin 1940 ; ainsi tous les magistrats, à une exception près, ayant prêté serment au maréchal Pétain (serment exigé par l'acte constitutionnel numéro 10 en date du 4 octobre 1941), sont les hommes qui ont, quelques mois plus tôt, jugé et condamné des gaullistes et des communistes, et doivent maintenant juger et condamner des collaborateurs. Une situation que la défense, lorsqu'elle sera libre de s'exprimer, ne se fera pas faute de dénoncer. Avec ses excès, ses négligences, ses lenteurs profitables aux accusés, la justice d'après septembre 1944 sera infiniment moins rude et moins sanglante que la justice sommaire des tribunaux du peuple ou des cours martiales, pour ne pas parler de la justice exercée à titre de représailles ou de vengeances.
De 30 000 à 40 000 Français ont été abattus, dans des proportions inégales suivant les régions. A Marseille 800 corps non identifiés auraient été jetés dans le Jarret. A Avignon, 46 exécutions sommaires recensées.
Dans la région de Limoges, près d’un millier, sans compter un charnier qui ne fut pas ouvert et dont on évalue le contenu à 200 ou 300, tués par les maquisards A Poitier, pas d’exécutions sommaires signalées parmi les Français : mais des prisonniers allemands, d’origine russe ou géorgienne sont massacrés sur la Place d’Armes, par une foule en délire. Dans les Deux-Sèvres, quelques exécutions sommaires. A Clermont-Ferrand, dans les quarante-huit-heures de troubles qui suivirent la libération, il y en aurait eu entre 130 et 150. Dans un rayon de 100 kilomètres à la ronde, l’exemple de la plus grande ville est suivi. A Bironde, le premier jour, une vingtaine d’exécutions. A Lyon, 7 à 800, A Lunéville, 30.
Tous ces meurtres Non pas la même origine. Les uns sont commis à la suite d’acte de trahisons indéniables perpétrés au profit des Allemands contre les troupes du maquis, les autres pour des raisons injustifiable.
Un exemple
Vers onze heures un mardi soir, une auto s’est arrêtée dans la cour et V, et est sorti par derrière de la maison pour aller dans l’obscurité se rendre compte de la qualité des visiteurs. Il avait le sentiment que (les maquis lui reprocheraient sa dénonciation. Entendant les occupants de la voiture descendre à terre et faire semblant de s’exprimer en allemand, le malheureux est allé vers eux et leur a dit ’’ AH! Vous êtes des Allemand, alors je n’ai rien à craindre de vous’’. Il avait lui-même prononcé sa condamnation à mort. Les autres ont joué le jeu.
Poursuivant toujours son idée il ne leur a fait grâce d’aucun détail en rajoutant encore, pour leur demander enfin (J’espère que vous aller libérer mes enfants pour me récompenser). Ils lui ont promis. Complaisamment, il leur a raconté comment (Alfred), de la Gestapo, était venu d’abord, qu’il l’avait retenu à déjeuner, qu'’il lui avait fait faire une belle omelette.
Les visiteurs du soir lui ont alors demandé de les conduire à l’endroit où étaient les conteneurs. Sa femme voulait d’abord les restaurer, ils ont refusé. Au retour, nous nous arrêterons. Le jeune fils voulait l’accompagner; eux n’ont pas voulu, il n’y avait pas de place dans la voiture, on ne devait plus le revoir vivant; un voisin a entendu, du côté des bois des coups de feu, vers 24 heures. Le narrateur conclut son récit en écrivant : Pauvre homme, moi qui sais les mobiles qui l’ont poussé à agir, je suis prêt à lui pardonner.
Les tribunaux d’exceptions

Procès populaire à la libération 1944
Au lendemain de la libération de Limoges par les Francs tireurs et partisans, le 22 août, leur chef, le colonel Guingouin, instaure un tribunal militaire (anticipant de trois jours sur l'arrêté du commandant des Forces françaises de l'intérieur, le colonel Rivier). Trois cents personnes comparaîtront devant la cour de justice militaire de Limoges, du 24 août 1944, date de sa première audience, jusqu'au 14 septembre. Soixante-quatorze seront condamnées à mort et toutes exécutées. Cette justice d'exception s'exposait à d'inévitables abus. On citera le cas d'un des condamnés par la même cour martiale de Guéret, qui passera devant le poteau d'exécution pour avoir, agent d'assurance, établi une police pour le camion et les locaux de la Milice. Les états de service remarquables de l'agent d'assurance pendant les deux guerres mondiales ne lui avaient valu aucune forme d'indulgence de ses juges. Lorsque le commissaire de la République, Pierre Boursicot, prendra ses fonctions, les cours martiales du Limousin auront largement entamé l'épuration.

Exécution de trois collaborateurs reconnus. Ils ont été fusilier
Comparés aux exécutions individuelles qui ne s'embarrassent d'aucune formalité et dont les victimes offrent le plus large éventail social et politique, quand il ne s'agit pas de vengeances personnelles, les jugements des tribunaux d'exception s'efforcent en général de conserver les apparences de la légalité, alors même, ne l'oublions pas, que la France n'est pas totalement libérée et que la guerre n'est pas terminée. Le sud de la France et plus spécialement le quart sud-ouest (le Limousin) voient se développer les tribunaux d'exception, ce qui n'est pas étonnant dans des régions où la Résistance s'est montrée très active, la répression allemande, parfois jumelée avec l’intervention de la Milice, la plus sauvage.
Le lynchage

Lynchage d’un collaborateur par des civils
Cette répression improvisée prend parfois un tour plus tragique. Sans s’embarrasser de scrupules juridiques, certains résistants assassinent des victimes convaincues – parfois sans preuves matérielles – de collaboration. Dès la Libération de Cavaillon, par exemple, un imprimeur qui a travaillé pour les Allemands est passé par les armes. Dans cette même ville, deux jeunes miliciens sont fusillés le 1er novembre 1944, bien que le préfet et le président du Comité de Libération aient tenté de s’interposer. Circonstance aggravante, un lynchage a précédé leur exécution.
Les miliciens de Grenoble

Les miliciens de Grenoble dans le box des accusés
Six jeunes miliciens de l'école de formation d'Uriage dans l'Isère, sont condamnés à mort, le 2 septembre, par la cour martiale de Grenoble et fusillés le jour même. Ces condamnations et ces exécutions ne retiendraient pas spécialement l'attention si l'on ne considérait le jeune âge des condamnés, l'absence de charges sérieuses à leur encontre (aucune forme d'engagement contre la résistance), les circonstances de leur arrestation, de leur condamnation et de leur exécution. Avoir été milicien pendant l'été 1944, et au-delà, et quelles que soient la nature de cet engagement et les responsabilités encourues, expose à l’exécution sommaire ou à la sévérité d'un tribunal d'exception.
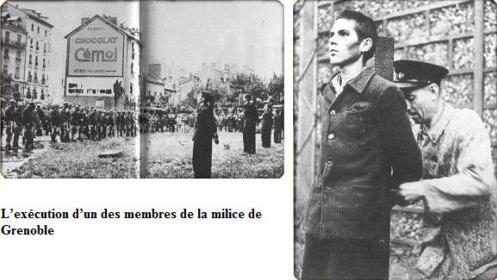
L’exécution d’un des membres de la milice de Grenoble
Les douze miliciens comparaissent devant une cour martiale, formée à l’initiative du préfet Reynier, assistés par un avocat, le choix d'un défenseur ayant rencontré mille difficultés. Les membres du Barreau, à Grenoble comme ailleurs, refusent le plus souvent de s'engager, voire de s'exposer. Grenoble ne fera pas l'exception. Le procès devant la cour martiale se déroule dans un chahut monstre d'une foule au comble de l'excitation qui couvre l'avocat, Me Guy, d'insultes et de menaces à tel point qu'on devra le faire escorter par des gendarmes.
La foule se retrouve, en masse, pour ne rien manquer de l'exécution des six condamnés à mort : les amateurs du spectacle se précipitent à pied, à bicyclette ou dans des voitures délabrées. Bientôt six corps s'affaissent sous les balles du peloton, dans le crépuscule froid et pluvieux de septembre. Le journaliste américain John Osborne qui rendit compte de l'événement dans le magazine Life écrivit que la foule fut prise d'un délire collectif et que les maquisards durent éloigner des individus qui cherchaient à atteindre les six cercueils où devaient être déposés les corps des victimes.

Milicien pendu à la libération 1944
Perpignan, quatre mille suspects sont soumis à des traitements horribles. L'abbé Niort, de Tautavel, âgé de 65 ans, a le thorax enfoncé et les côtes cassées. On lui arrache les ongles, les cheveux et des morceaux de chair avec des tenailles. Condamné par une cour martiale, on doit lui faire des piqûres pour qu'il tienne jusqu'au poteau. Dès qu'il s'effondre, la foule se précipite sur son cadavre. Des femmes frappent le mort. D'autres urinent sur lui. Quelques mois plus tard, l'abbé sera réhabilité à titre posthume. A Aix-en- Provence, sur le majestueux cours Mirabeau, les cadavres de trois jeunes miliciens pendus se balancent plusieurs jours. Dessous, on fait défiler les enfants des écoles. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre.
Massacres à Nîmes
Nîmes, le maître des cérémonies est le commandant Boulestin, de son vrai nom, Teussier, ivrogne notoire qui, jusque-là, vendait des cacahuètes et des lacets dans les rues. Il se déplace en voiture sur laquelle il a fait peindre son nom de guerre en lettres énormes. Le noyau des F.T.P. de la ville est constitué d'Espagnols rouges, d'Indochinois du Mouvement Ouvrier International et de Russes de l'armée Vlassov qui ont changé de camp. L'exploit principal de Boulestin est l'organisation des tueries sur la place des arènes de NÎmes, le 28 août 1944.

La chasse aux collaborateurs dans le sud de Nîmes
Ce jour-là, il prend livraison de neuf miliciens à la prison populaire. Il les fait aligner les bras levés, puis il organise un défilé à travers la ville. On jette sur les malheureux des détritus et on les frappe. Un haut-parleur convie les honnêtes citoyens à participer aux réjouissances. Arrivés aux arènes, les suppliciés sont collés au mur. Couvrant les cris de la foule, les fusils crépitent. Des énergumènes se précipitent. Ils écrasent les corps à coups de talon. Des femmes hystériques trempent leur mouchoir dans leur sang. La scène dure deux bonnes heures. C'est là que sera exécuté dans d'atroces conditions, Angelo Chiappe, préfet régional d'Orléans, ancien préfet de NÎmes où, à la Libération, on le réclama. A partir du 9 septembre, toujours à Nîmes, une cour martiale juge les suspects par paquets de 20. La foule se rue sur les accusés à leur arrivée pour les frapper. Ce jour-là, il y a 6 exécutions. Le 11 septembre, on en tue 5 autres, ainsi que le 14 et le 18. On exécute aussi en dehors de cette procédure. On exécute après un simulacre de jugement le président du Tribunal de Nîmes, le préfet de la Lozère, Dutruch, ou le commandant de gendarmerie Brugnère, que l'on réhabilitera ensuite. Les corps des victimes sont entreposés dans la cour du lycée avant d'être jetés à la fosse commune. On en dénombre parfois 34 ensembles.
Le petit Godard

L’épuration à la libération des collaborateurs
A Paris, il y a plusieurs prisons clandestines mais la geôle la plus sinistre est installée à l'Institut dentaire de l'avenue de Clichy, où sévissent d'authentiques truands, tel José Redrossa, et des spécialistes de la torture. L'un des anciens pensionnaires de l'établissement en a conté les scènes hallucinantes Les F.T.P. ont amené Godard. Godard, c'était le jeune homme qui s'était jeté du second étage, la veille, parce qu'on le torturait trop. Il n'avait que vingt ans. Mais il avait appartenu à la L.V.F., le petit imbécile. Et les F.T.P. n'aimaient pas ça. Ils l'ont battu et torturé plusieurs fois, là-haut, au second étage, avec je ne sais quelle science chinoise. C'était trop pour ce petit Godard de vingt ans. A un moment, sans doute, il n'a pu en endurer plus, de tout son corps d'enfant qui souffrait, qui saignait. Il a voulu s'échapper, n'importe comment. Il s'est jeté à travers la fenêtre, emportant au passage du bois, des vitres. Et ils l'ont ramassé en bas, les jambes brisées. L’un d'eux l'a rapporté dans la salle, sur son épaule. Et les jambes de Godard lui pendaient dans le dos, comme des choses mortes.

Épuration en France en 1944-1945
Ils l'ont jeté sur une paillasse, dans un coin. Il est resté là toute la nuit. Et ce fut un drôle de nuit. Personne n'a pu dormir. Les prisonniers jusqu'au matin ont entendu le petit Godard qui avait voulu fuir la torture et qui n'avait pas réussi. Il a souffert toute la nuit par ses jambes brisées. Il criait de douleur. Il appelait sa mère. Ou bien il râlait, longuement, comme s'il allait mourir. Nul ne l'a soigné, puisqu'il devait être fusillé au matin. C'eût été du temps perdu. Les F.T.P., parfois, en passant, le traitaient de salaud, et lui ordonnaient de se taire. Au matin, donc, ils l'ont amené jusqu'au mur, sur un brancard. Ils ont essayé de le mettre debout, de le faire tenir, tant bien que mal, en l'appuyant au mur, pour le fusiller, selon les règles. Mais le petit Godard s'est aussitôt effondré, sur ses jambes brisées. Alors ils l'ont remis sur le brancard et ils l'ont tué dessus. C'est ainsi qu'a fini de souffrir le petit Godard.

La chasse aux notables de 1944
La liste serait interminable de ces notables assassinés en raison de leur fonction sociale : le général Nadal ; Lacroix, syndic de la corporation paysanne de Haute-Savoie ; Daniel Bedaux, ancien adjoint du général de Castelnau. Le baron Henri Reille-Soult, notable de la Vienne et authentique résistant, est assassiné le 19 octobre 1944. En Haute-Savoie, le comte de Sales est abattu en pleine rue, alors que deux gendarmes le conduisent au tribunal. Dans le Puy-de-Dôme, le grand aviateur Jean Védrines est abattu sous les yeux de sa femme et de ses enfants. Il avait été attaché pendant quelques semaines au cabinet du maréchal Pétain en1940.
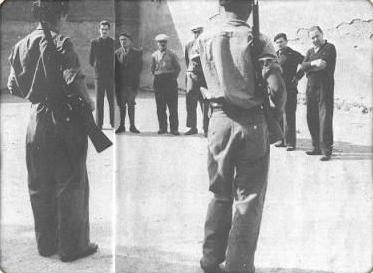
Notables surveillé par deux gardes armées du Front de Libération
Le comte Christian de Lorgeril, âgé de 59 ans, combattant des deux guerres, est propriétaire d'un vaste domaine et d'un château historique. Sous le prétexte qu'il a toujours professé des idées monarchistes, les F.T.P. l'arrêtent le 22 août 1944. Complètement dévêtu, le malheureux est d'abord contraint de s'asseoir sur la pointe d'une baïonnette. Puis les tortionnaires lui sectionnent les espaces métacarpiens, et lui broient les pieds et les mains. Les bourreaux lui transpercent le thorax et le dos avec une baïonnette rougie au feu. Son martyre n'est pas fini. Il est plongé dans une baignoire pleine d'essence. Leur victime s'étant évanouie, ils le raniment en l'aspergeant d'eau pour répandre ensuite sur ses plaies du pétrole enflammé. Le malheureux vit encore. Il ne mourra que cinquante-cinq jours plus tard, dans des souffrances de damné. Les responsables de ce crime et de bien d'autres, commis notamment sur la personne de détenus à la prison de Carcassonne, seront traduits plus tard devant les juges. Trois furent condamnés à 10, 7 et 5 ans de prison. Les autres furent acquittés. Leurs avocats avaient invoqué les instructions du général de Gaulle comme les défenseurs de miliciens invoquèrent celles de Pétain.
Le salon de l'épicier
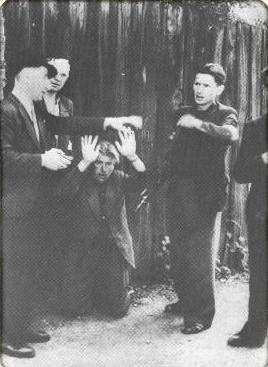
La chasse aux collaborateurs en France 1944
Voici le collabo jeté dans une pièce qui a dû être le salon de l'épicier. S'y trouvent déjà un gendarme portant au front la mention vendu, tracée à l'encre, un négociant de Marmande dont le visage tuméfié dit le traitement qu'il a da subir, trois dames légères au crâne rasé et un garçon de quatorze ans, qui s'est inscrit aux Jeunes du P.P.F. Au cours de la nuit, le salon reçoit un nouvel hôte. Un garagiste de La Réole. Il a été sérieusement tabassé pour avoir effectué des réparations aux voitures des officiers allemands. L'un de ses cousins, accusé d'avoir vendu sa marchandise aux occupants, a été, avec sa femme et son fils, collé à un mur et abattu à la mitraillette. Un des gardes-chiourme leur apporte du pain. Ce sera le seul ravitaillement durant les trois jours et les trois nuits passées dans cette première geôle. Le gardien leur annonce l'arrivée d'une grosse prise. Un dénonciateur capturé à Nérac. Vous allez entendre ce que vous allez entendre. L'homme est enfermé dans la cave. On entend les coups mats de gourdins et de nerfs de bœufs assenés sur son corps nu. Cela dure des heures. Parfois les hurlements cessent. Mais le supplice n'est pas achevé. De longs râles disent qu'il n'a pas fini de souffrir. Il sera achevé au matin.

Après la libération de Nancy, un collaborateur est forcé de tenir au dessus de sa tête la photographie d’un officier allemand.

Après la libération de Paris place des Pyramides. Des membres des Forces Françaises de l’Intérieur prennent sous leur protection un individu malmené par la foule qui avait déchiré son pantalon.

D’abord des images terribles en noir et blanc : celles d’un homme qu’une foule en furie maltraite, brutalise, frappe puis accroche par les pieds en haut d’un lampadaire. L’homme se débat. Ses gestes se font ensuite plus rares et, enfin, du moins on le devine, il meurt. La corde qui le retenait est coupée sans ménagement et son corps tombe au sol comme un vulgaire paquet de linge sale. On avait déjà pu voir ces images dans le film Été 44 de Patrick Rotman, qui les avait utilisées à l’état brut, sans commentaire. Daniel Scheidemann a eu l’excellente idée de chercher à en savoir plus et de mener, avec la collaboration de Christelle Ploquin, une enquête sur cette scène atroce qu’on avait d’abord située à Vichy pendant l’été 1944. En fait, la scène se passe à Cusset, un petit village proche de Vichy, et se déroule le 2 juin 1945, soit près d’un an après la Libération. Plus que la révélation de ce décalage chronologique, c’est la reconstitution de la genèse de cette tragédie, par le croisement des témoignages et des documents, qui donne tout son intérêt historique.
Personnages célèbres emprisonnés

Arletty, une prisonnière célèbre
Parmi les plus célèbres de ces prisonniers n'y a-t-il pas la comédienne Arletty (à gauche) qui, au moment de l'épuration, a déjà inscrit son nom au générique de chefs-d’œuvre tels que Hôtel du Nord, le jour se lève ou les visiteurs du soir, une vedette à qui l'on reprochait d'avoir eu des relations avec des duchesses et des comtesses. Arrêtée, elle se retrouvera dans la même geôle que Tino Rossi qui, lui, offrait sa voix aux autres détenus, pendant les offices religieux.
Également enfermée: Mary Marquet l'actrice de théâtre entrée depuis vingt ans à la Comédie française où elle était devenue sociétaire et à qui on reprochait des articles écrits dans la revue Aujourd'hui, une revue dont le directeur n'était autre que Georges Suarez, l'un des journalistes fusillés.
Pierre Fresnay, également inquiété et emprisonné passait son temps de réclusion à frotter son carrelage à la paille de fer. Cet acteur qui était lui aussi passé par le théâtre, notamment le Français, avant d'être appelé par le cinéma, fut révélé au grand public dans le corbeau. C'est justement ce rôle du docteur Germain accusé par des lettres anonymes d'être l'amant de l'épouse de l'un de ses confrères dans une petite ville de province, qui va faire de Pierre Fresnay un homme suspect aux yeux des membres de ces juridictions d'exception. Le film, présenté dans les salles de cinéma outre-Rhin sous le titre Province française, et son interprète principal furent accusés d'avoir voulu réaliser une entreprise d'avilissement propre à montrer la dégénérescence du peuple français à travers les habitants d'une petite ville provinciale.

L’arrestation de Sacha Guitry par la Résistance 1944
Le 23 août 1944 à 10 heures du matin Sacha Guitry est arrêté à son domicile par deux hommes armés. On ne lui laisse pas le temps de s'habiller et on l'entraîne dehors. Pour un spectacle, c'est un spectacle ! L'auteur dramatique se décrira lui même: Mon pyjama se compose d'un pantalon jaune citron et d'une chemise à larges fleurs multicolores. Je suis coiffé d'un panama exorbitant, et quant à mes pieds, qui sont nus, ils sont chaussés de mules de crocodile vert jade. Il est conduit ainsi vêtu, par les rues, jusqu'à la mairie du VII" arrondissement où il est brièvement interrogé dans la cellule 117. Ce 23 août commencent les épreuves de Sacha Guitry en prison et ses démêlés avec la justice. Il racontera d'ailleurs tout cela dans un ouvrage édité en1949 qui s'intitule Soixante jours de prison et qui succède à Quatre ans d'occupations paru en octobre 1947. On l'accuse d'antisémitisme lui qui, dénoncé par le Pilori, est obligé de se disculper de l'être alors même qu'il vient en aide à des amis juifs. De là à l'arrêter... Depuis 1942, Radio Londres et les journaux de la Résistance font circuler des listes noires de collaborateurs. Dans l'un de ces journaux, Guitry est condamne a mort. L’époque de souffrance se prête à la revanche. Le seul fait d'avoir fréquenté l'ennemi est considéré comme suspect. Guitry ne peut nier ses fréquentations et tous les arguments développés dans ses livres de souvenirs écrits après l'occupation ne peuvent occulter certains faits accomplis au moment où des hommes et des femmes mouraient sous la torture, les balles et la hache, dans des camps.

Pendant l'Occupation, Sacha Guitry ne va pas manquer d'occupations et ce sont elles qui vont le mener, en fonction de l'interprétation qu'on leur donne, au respect ou au déshonneur. Lorsqu'il arrive à Paris il fait des démarches auprès du préfet Jean Chiappe et du recteur de l'Académie de Paris chargé des affaires culturelles pour obtenir la réouverture des théâtres, et il reprend dans son théâtre de la Madeleine une pièce créée en 1919 : Pasteur. Le voilà aux prises avec les autorités allemandes qui, devant le nationalisme de la pièce, veulent la censurer. Encore une fois des démarches. Encore une fois il obtient gain de cause. L'homme est habitué aux succès. Il n'a connu que la gloire. Tout cela lui paraît naturel. Tout au long de la guerre, les interventions, les sollicitations auprès des Allemands vont se succéder. Sacha en a les moyens, il a l'impunité des gens célèbres, il a les relations et les occasions ne manquent pas. A la prison de la Santé, il est enfermé dans la cellule 42 avec ex-ministre de l'Éducation de Pétain. Prisonnier, il subit menaces, insultes et aussi... demandes d'autographes. Pour qui est habitué au confort de l'hôtel particulier, la promiscuité, la saleté, le manque d'hygiène tout cela n'est pas très réjouissant. Le prisonnier reçoit quelques colis apportés par son chauffeur. Bientôt Tristan Bernard intercède auprès du juge d'instruction en faveur de celui qui l'a sauvé en 1943. Le 24 octobre 1944, deux mois après son arrestation, Sacha Guitry est libre. Le 8 août 1947, le commissaire du gouvernement rend une décision de non lieu, rien n'ayant été trouvé au cours de l'enquête et beaucoup d'accusations ayant été reconnues comme fausses.

Paul Morand 1888-1976 Auteur d’Ouvert la nuit, ami de Proust, publie en 1941 son chef-d’œuvre, l’Homme pressé. Décoré de la francisque, ministre plénipotentiaire. Préside la Commission de Censure cinématographique. Laval le nomme ambassadeur à Berne en juillet 1944 pour lui éviter l’épuration.

Jean Giono Ses romans célébraient la terre avant que Vichy n’y trouve un de ses mythes. Mis à l’index pour avoir beaucoup côtoyé l’occupant. La NRF de Drieu publie ses textes etla Gerbe ses entretiens, trois de ses pièces sont montées à Paris occupé. Incarcéré cinq mois à Saint-Vincent-les-Forts, libéré le 2 février 1945.

Lucien Rebatet Une des meilleures plumes de la collaboration, mais aussi l’une des plus violentes. Critique musical et cinématographique, entre à Je suis partout dès 1933. Auteur des Décombres, best-seller de l’Occupation, paru chez Grasset en 1942 et tiré à100000 exemplaires. Condamné à mort le 23 novembre 1946, puis gracié. Amnistié en juillet 1952.

Georges Suraez Premier intellectuel fusillé. Ancien biographe de Briand, Poincaré, Clemenceau. Anti-allemand durant la drôle de guerre. Compagnon de Doriot puis de Déat. Se rapproche d’Abetz. Juger pour ses articles dans Aujourd’hui, journal subventionné par l’occupant. Condamné à mort et exécuté le 9 novembre 1944.

René Bousquet, (en col de fourrure)
Secrétaire général à la Police en avril 1942. Signe avec Oberg (chef de la Gestapo en France) les accords autorisant la livraison par la police française des juifs étrangers. Condamné en 1949 à cinq ans de dégradation nationale, peine levée aussitôt pour services rendus à la Résistance. Abattu à Paris le 8 juin 1993.

Charles Maurras Maître à penser de l’intelligentsia nationaliste du début du siècle. Patron de l’Action française. Accueille l’avènement de Pétain par un célèbre divine surprise! Dépassé en virulence par ses anciens disciples, référence constante d’un Brasillach ou d’un Vallat. Condamné en 1945 à la réclusion criminelle à perpétuité. Mort en 1952.

Henri Béraud Prix Goncourt 1922 pour le Martyre de l’obèse. Éditorialiste de l’hebdomadaire Gringoire. Auteur du brûlot Faut-il réduire l’Angleterre en esclavage? Deviendra collaborationniste militant. Condamné à mort peine commuée en réclusion à perpétuité puis à résidence surveillée dans sa maison de l’île de Ré, où il meurt en 1958.

Pierre Drieu La Rochette Symbole d’une génération d’intellectuels qui crut déceler dans l’Allemagne nazie un renouveau de l’Europe. Écrit dans «Révolution nationale» des articles résolument fascistes et européens. Dirige la prestigieuse NRF de Gallimard, où il fait entrer Bonnard et Fabre-Luce. Se suicide le 16 mars 1945.
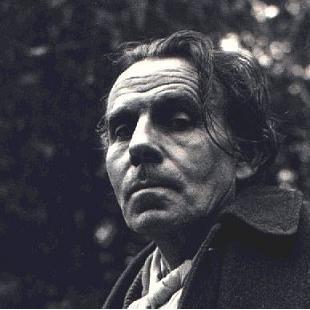
Louis-Ferdinand Destouches, dit Céline En juin 1940, hésite à s’embarquer pour l’Angleterre. Publie dès 1941 les Beaux Draps, pamphlet politique violemment antisémite. Stigmatise la mollesse du commissariat aux juifs de Vallat. Fuit au Danemark. Condamné à un an de prison par contumace en 1950 et à l’indignité nationale, rentre un an plus tard.

Louis Renault Fondateur des usines Renault, soupçonné d’avoir freiné l’effort de guerre demandé par Daladier en 1939, puis livré à l’Allemagne plus de 32000 véhicules durant l’Occupation. Meurt en prison le 24 octobre 1944. Le 15 novembre est décidée la confiscation des biens de la Société des Usines Renault.
Il est toujours difficile de modérer une troupe que l'on a mobilisée sur des thèmes insurrectionnels. M. Paganelli ne fut pas le seul commissaire de la République à en faire la dure expérience. A trois reprises, à Lyon, Yves Farges se heurte aux excités de la rue. Une première fois, il est arrêté par des jeunes gens armés qui prétendent le reconnaître comme un collabo. Il ne doit son salut qu'à des amis qui le suivaient et qui interviennent. Les deux autres aventures sont directement liées au combat que Farge mena contre l'épuration sauvage. Un jour, il est alerté par le préfet de la Drôme alors qu'il vient de gracier un condamné à mort jugé à Valence. Selon le préfet, une manifestation organisée pour protester contre cette clémence risque de dégénérer en émeute. Yves Farges se fait conduire aussitôt sur place et décide les protestataires à le suivre dans une salle des fêtes où il leur expliquera les motifs de sa décision. Conspué sans arrêt par une majorité de F.T.P., il apprend bientôt que, tandis qu'il parlait, la foule a enfoncé les portes de la prison et fusillé le condamné ainsi que quatre autres détenus. Quelque temps après, la Cour de cassation ayant annulé la sentence qui condamnait à mort l'ancien préfet Ani Éli, une foule furieuse envahit la prison Saint-Paul à Lyon. Mais Farge, qui a été prévenu, joue d'audace. Lorsque la cohue arrive à la cellule d'Angéli, elle trouve Farges debout sur le lit entourant de ses jambes le prisonnier. -Vous ne toucherez pas à un cheveu de cet homme, tant que je serai vivant, dit-il.
La sanglante épuration spontanée de 1945 en Italie
Les pertes des antifascistes seraient de 29 000 personnes, ainsi réparties :
6 000 partisans tués au combat; 13 000 fusilliers par représailles, ou mort en déportation dans les camps allemands (ce chiffre comprendrait également les nombreux partisans communistes qui furent abattus par des partisans communistes;
10 000 civils fusillés en représailles, soit par les forces allemandes, soit par les forces fascistes.
Les pertes fascistes seraient de 75 000 personnes, ainsi réparties :
7 000 soldats tués au combat; 12 000 fascistes abattus par les partisans pendant la guerre civile; 10 000 Italiens de la Vénétie Julienne, de L’Istrie et de la Dalmatie éliminés comme (fascistes) par les partisans yougoslaves.

Quatre solides partisans encadrent cette femme sans grand relief. Accusée d’avoir proféré des opinions qui ne cadre plus avec celle du nouveau régime. Ou peut-être d’avoir trop bien accueilli des militaires allemands.

Un fasciste passe devant les juges populaires soigneusement gardé par une jeunesse joyeuse, armé jusqu’aux dents.
On fusille beaucoup comme sur la photographie; à Milan, où des partisans vont régler leur compte à quelques prisonniers italiens et allemands.

Les prisons italiennes se sont remplies instantanément de (politiques) ou en instance de jugement. Mais la justice du peuple est plus expéditive.
Les cadavres des hiérarques fascistes exécutés sommairement à Milan.

La chasse aux fascistes a pour théâtre les principales artères des villes et villages d’Italie

Ce que l’on voyait dans les rues de Milan, après le départ des troupes allemandes. Des partisans armés soumettant les habitants des interrogatoires sur les agissements de leurs voisins.

Maria Nencioni ex-secrétaire du général Graziani dont le procès est venue devant la cour de Milan. Carlo Emanuele Bassile, ancien préfet de Gênes, est derrière les barreaux.
Le massacre des femmes
Certains épisodes de cette épuration révèlent l’ampleur du déchainement populaire. Donato Carreta, directeur de la prison romaine de Regina Coeli, venu témoigner dans un procès, est entouré par la foule à la sortie du tribunal; une femme l’accuse d’avoir livré son mari aux Allemands. On s’empare du directeur de la prison, on l’amène jusqu’au Tibres, et au milieu des hurlements de la foule, il est précipité dans le fleuve. Il parvient à nager et à regagner l’autre rive; on le rejette à l’eau, il lutte encore quelques temps, puis enfin il se noie. Tandis que la foule hurle de joie en assistant à ses ultimes convulsions. De nombreux épisodes aussi dramatiques resteront longtemps dans les mémoires. L’épuration n’épargne pas les femmes. Dans la région de Rome, 7 000 femmes environ furent massacrées, 5000 autres furent jetées en prison, et 20 000 tondues et violentés.

L’un des principaux dirigeants fasciste Buffarini Guidi a été fusilier dans le dos.

A Milan, la salle de la cour d’assises où étaient jugés les procès de collaborateurs.
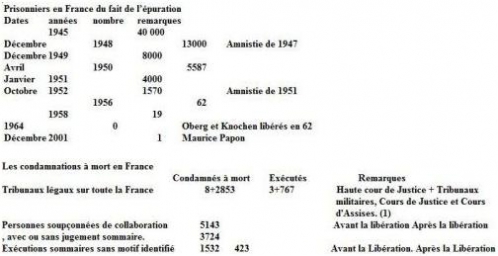
L’épuration a été violente. Dans la seule agglomération de Bordeaux, 1399 personnes étaient déjà arrêtées le 18 septembre1944. En fin 1948, la Cour régionale de justice avait prononcé 882 verdicts dont, pour le département : 66 condamnations à mort (15 condamnés réellement exécutés), 340 peines de travaux forcés, 19 peines de réclusion, 239 peines d’emprisonnement et 141 acquittements.
Le Tribunal militaire de Bordeaux a jugé 1885 affaires, avec 24 condamnations à mort (12 exécutions), 187 peines de travaux forcés, 466 peines de prison, 6 amendes, 289 acquittements, 831 absous, 6 amnisties à l’audience, 69 actions éteintes. La Chambre civile a traité 1963 cas, et prononcé 1379 indignités nationales.
Adrien Marquet, maire de Bordeaux, fit 41 mois de prison avant d'être jugé et acquitté. Il fut seulement condamné à 10 ans d'indignité nationale.
Remarques : Dans une émission de télévision, un membre de cette Chambre civile a rappelé que ceux qui avaient été convaincus de s'être enrichis en profitant de l'occupation avaient été dépouillés de tous leurs biens.
Les malgré-nous d’Oradour sur Glane
Le sort avait fait que 14 Alsaciens faisaient partie de la compagnie du régiment Der Führer qui commit le massacre d’Oradour sur Glane, dont 12 étaient des malgré-nous c’est à dire des incorporés de force. Dans la suite de la guerre, quelques uns désertèrent, et se battirent ensuite dans les FFI ou dans l’Armée. Certains avaient fondé des familles lorsque la Justice vint leur demander des comptes d’après une loi de 1948 à effet rétroactif (déjà), portant sur les crimes collectifs. Ils furent jugés à Bordeaux (déjà) et furent condamnés, le 13 février 1953, à des peines de 5 à 8 ans de réclusion. Certains avaient réellement participé au crime, mais il fut tenu compte qu’ils n’avaient que 18 ans au moment des faits. Qui pouvait prétendre qu’il aurait osé refuser d’obéir dans la SS ? C’était la douleur du Limousin contre celle de l’Alsace, et la France en fut bouleversée. Le Président du Conseil, René Mayer, proposa une loi d’amnistie pour les malgré-nous, qui fut votée par 318 voix contre 211. Les malgré-nous furent tous libérés dès le 21 février. Deux condamnés à mort, dont un Alsacien volontaire pour la SS, furent graciés, et furent libérés en 1958.
Le général de Gaulle et l’épuration
Le général voulut que l’épuration soit courte, et fit preuve d’une grande clémence que les communistes lui reprochèrent avec véhémence. Il pensait que la vengeance était contraire à la démocratie, et que les peines les plus sévères devaient être réservées à ceux qui avaient utilisé la guerre à des fins personnelles.
Au total, de la Libération jusqu’à sa démission en janvier 1946, 1594 recours en grâces lui furent présentés pour des condamnés à mort de tous les tribunaux existants : Haute cour de Justice pour les hommes politiques, Cours martiales qui furent remplacées par les Cours de justice, Tribunaux militaires jugeant les trahisons, Cours d’Assisses, Juridiction Coloniale et Tribunaux militaires jugeant les crimes de guerre. Le général De Gaulle accorda 998 grâces pour ces 1594 recours.
Le général De Gaulle et le Maréchal Pétain
Le Général déclara, en 1945 : Aujourd’hui, il y a un vieillard dans un fort dont moi et beaucoup d’autres reconnaissons qu’il a rendu de grands services à la France.
En mars 1948, à Verdun, il évoqua le : le grand chef de la Grande Guerre emporté sous l’effet de l’âge, par le torrent des abandons.
En mars 1949, lors d’une conférence presse, il déclara: que la condamnation de Pétain était nécessaire car il avait symbolisé ce que fut la capitulation et, même s’il ne l’avait pas voulu, la collaboration
Le 15 mars 1950, devant la Presse, il dit : S’il fallait une preuve de la carence du régime, cette question brûlante et amère nous la donnerait. C’est un opprobre que de laisser en prison un homme qui va avoir 95 ans.
De nos jours, des journalistes et des hommes politiques ne reconnaissent pas que le général de Gaulle fut un grand homme, mais le maintien en prison de Maurice Papon prouve certainement que les hommes politiques actuels sont bien petits.